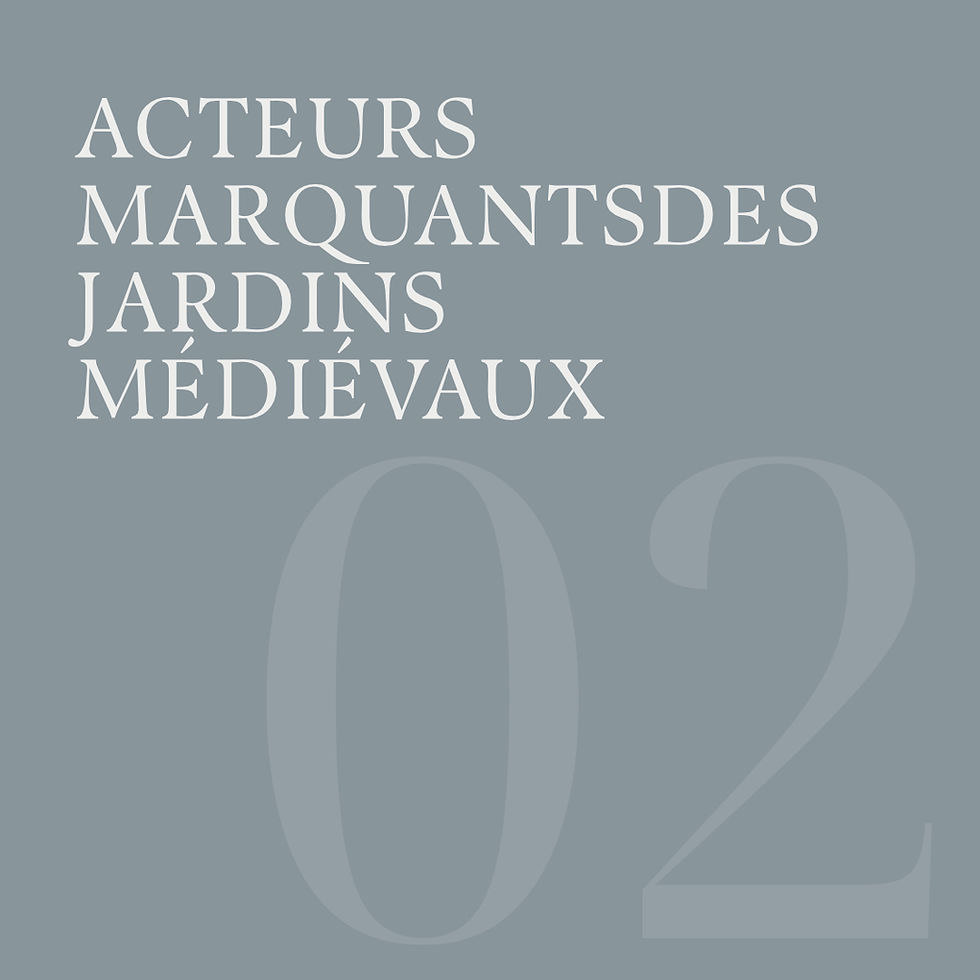Les jardins médiévaux : symbolisme et utilité
- Ivy Cousin

- 17 févr. 2025
- 57 min de lecture

Résumé
Les jardins médiévaux ne se limitaient pas à de simples espaces de culture : ils étaient le reflet d’un savoir-faire structuré, alliant symbolisme religieux, utilité économique et organisation rigoureuse. Présents dans les monastères, les châteaux seigneuriaux et les villes, ils répondaient à des besoins variés : production alimentaire, médecine, méditation spirituelle et représentation du pouvoir.
Les jardins monastiques, influencés par la règle bénédictine et le Capitulare de Villis de Charlemagne, étaient divisés en trois espaces principaux :
L’hortus (potager) fournissant légumes et herbes aromatiques,
L’herbularius (jardin médicinal), où étaient cultivées des plantes aux vertus thérapeutiques,
Le verger ou viridarium, mêlant arbres fruitiers et végétaux symboliques.
Les jardins seigneuriaux et princiers, quant à eux, étaient à la fois des espaces utilitaires et des lieux d’agrément. Inspirés des jardins courtois décrits dans le Roman de la Rose, ils étaient soigneusement aménagés avec fontaines, treilles et allées symétriques, illustrant le raffinement et la puissance de leurs propriétaires.
En milieu urbain, les jardins étaient souvent de taille réduite, intégrés aux maisons ou situés aux abords des remparts. Ils servaient principalement à la culture vivrière et jouaient un rôle dans l’économie locale, notamment grâce aux ceintures maraîchères qui entouraient les villes.
Au-delà de leur fonction matérielle, les jardins médiévaux étaient chargés de symbolisme religieux. Le hortus conclusus, jardin clos évoquant le Paradis et la pureté de la Vierge Marie, est une représentation emblématique de cette époque. Dans l’iconographie et la littérature, ces jardins étaient perçus comme des espaces d’ordre et d’harmonie, où chaque plante possédait une signification spirituelle.
Grâce aux traités d’agronomie médiévaux, comme le Liber Ruralium Commodorum de Pierre de Crescens, l’aménagement et l’entretien des jardins suivaient des principes précis, intégrant des techniques d’irrigation avancées et une organisation méthodique des cultures.
L’héritage de ces jardins se retrouve aujourd’hui dans certains sites restaurés, témoignant du savoir horticole et spirituel du Moyen Âge. Ce patrimoine, à la fois fonctionnel et symbolique, illustre une relation unique entre l’homme et la nature, où le travail de la terre était aussi un acte de foi et de transmission des savoirs.
L'article
Les jardins médiévaux ne se limitaient pas à de simples espaces de culture : ils incarnaient une organisation savante où se mêlaient savoirs botaniques, nécessités économiques et symbolique spirituelle.
Monastiques, seigneuriaux ou urbains, ils répondaient à des impératifs précis, reflétant une vision du monde où l’ordre naturel s’inscrivait dans une conception théologique et sociale rigoureuse.
Afin d’approfondir les notions abordées, un glossaire accompagne cet article pour clarifier les termes spécifiques, ainsi qu’une bibliographie détaillée recensant les principales sources et études sur le sujet.
Introduction
Au cœur du paysage médiéval, les jardins occupaient une place centrale, tant dans la vie quotidienne que dans l’imaginaire collectif. Qu’ils soient monastiques, seigneuriaux ou urbains, ces espaces ne se limitaient pas à de simples lieux de culture vivrière. Ils étaient le reflet d’une organisation rigoureuse, d’un savoir transmis et enrichi par les siècles, ainsi que d’une vision du monde où la nature et l’homme s’accordaient dans un équilibre subtil. Dès le haut Moyen Âge, ils héritèrent des traditions antiques et monastiques, structurant ainsi un art horticole qui marqua durablement l’histoire paysagère française.
La présence des jardins dans les monastères fut essentielle à leur préservation et à leur évolution. Dès l’époque carolingienne, Charlemagne réglementa leur organisation dans son Capitulare de Villis, un texte législatif énumérant les plantes devant être cultivées sur les domaines impériaux. Il y précisait la nécessité de jardins clos, où devaient être entretenues des plantes médicinales, des légumes et des arbres fruitiers. Ce modèle se retrouva dans les abbayes bénédictines et cisterciennes, qui firent du jardin un élément essentiel de leur vie communautaire. À l’abbaye de Saint-Gall, en Suisse, un plan du IXe siècle témoigne de l’organisation minutieuse des espaces verts : un hortus conclusus dédié aux plantes médicinales, un verger, un potager et des zones d’agrément. Ce cloisonnement répondait non seulement à des besoins alimentaires et médicinaux, mais aussi à une symbolique spirituelle forte. Saint Bernard de Clairvaux, dans ses écrits, évoquait le jardin du monastère comme un espace où la nature ordonnée reflétait la perfection divine, à l’image de l’Éden biblique.
Dans les domaines seigneuriaux, les jardins s’inscrivaient dans une dynamique différente. Destinés autant au loisir qu’à la production, ils se situaient à proximité des châteaux et adoptaient une structure géométrique marquée par des parterres bordés de haies ou de palissades. On y trouvait souvent un verger et des espaces d’agrément où la noblesse venait se détendre. La littérature courtoise du XIIe siècle, notamment le Roman de la Rose, en fait un décor récurrent des intrigues amoureuses, décrivant des lieux clos où la nature domptée servait de cadre aux échanges galants. Cette conception du jardin comme espace de plaisir se retrouve également dans les représentations iconographiques, comme celles des tapisseries de La Dame à la Licorne, où l’enclos fleuri symbolise un univers à la fois intime et enchanteur.
En milieu urbain, le jardin avait une fonction avant tout utilitaire. Les espaces réduits contraignaient les habitants à aménager de petits jardins clos à proximité des maisons. Les documents cadastraux du XIVe siècle montrent qu’à Paris, à Aix-en-Provence ou encore à Senlis, chaque demeure possédait un espace cultivé, souvent appelé courtil ou hortus parvus. Ces jardins servaient à la culture de légumes et d’herbes médicinales, mais aussi à l’élevage de petits animaux. Dans certains cas, ils se prolongeaient jusqu’aux remparts des villes, formant une ceinture maraîchère essentielle à l’approvisionnement des marchés urbains. L’ordonnance du prévôt de Paris en 1472 témoigne de leur importance, réglementant leur accès et leur usage afin de préserver ces précieuses zones vertes.
Au-delà de leur fonction pratique, les jardins médiévaux étaient chargés de symboles. Dans l’iconographie religieuse et les textes théologiques, ils représentaient à la fois l’Éden perdu et l’harmonie céleste. L’hortus conclusus, jardin clos par excellence, était souvent associé à la Vierge Marie, pure et préservée du monde extérieur. Les enluminures des manuscrits médiévaux, comme celles du Bréviaire de Belleville, montrent fréquemment la Vierge dans un jardin foisonnant de lys et de roses, témoignant de cette lecture allégorique. La symbolique du jardin se retrouve également dans la liturgie et les rituels chrétiens. Ainsi, certains cimetières médiévaux étaient conçus comme des vergers, leur organisation reflétant une vision où la nature accompagnait le cycle de la vie et de la mort.
L’agencement des jardins médiévaux répondait à une organisation savante, dictée par des traités d’agronomie qui circulaient parmi les élites lettrées. Pierre de Crescens, dans son Liber Ruralium Commodorum rédigé au XIIIe siècle, détaillait les méthodes de culture et les principes d’implantation des jardins. Il recommandait notamment une disposition carrée, privilégiant les alignements rectilignes pour une meilleure gestion de l’espace et de l’irrigation. Les jardins monastiques et seigneuriaux appliquaient souvent ces préceptes, intégrant des systèmes d’irrigation rudimentaires à l’aide de canaux et de rigoles, comme en témoignent les vestiges retrouvés dans certains sites archéologiques.
La transition vers la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance marqua une évolution des conceptions du jardin. L’influence italienne se fit progressivement sentir, avec l’introduction de nouvelles espèces et une organisation plus ornementale des espaces verts. Toutefois, l’héritage médiéval subsista dans de nombreux aspects, notamment dans la persistance des jardins clos et des vergers monastiques, dont certains perdurent encore aujourd’hui.
Les jardins médiévaux, loin d’être de simples espaces fonctionnels, étaient donc des lieux à la croisée du sacré et du quotidien, du travail et du repos, du privé et du collectif. Ils témoignaient d’un rapport particulier entre l’homme et la nature, où l’organisation spatiale et la diversité végétale répondaient à des besoins à la fois matériels et spirituels. En France, cet héritage se retrouve dans l’aménagement de nombreux jardins historiques, qui portent encore la trace de cette organisation rigoureuse et de cette vision du monde façonnée par les siècles.
Les jardins médiévaux s’inscrivent dans une tradition plus vaste, héritée des savoirs antiques et façonnée par les besoins de la société médiévale. Leur développement en Europe occidentale résulte d’une synthèse entre les pratiques agricoles romaines, l’organisation monastique et les exigences des seigneuries et des bourgs en pleine expansion. Structurés selon des principes à la fois pratiques et spirituels, ils se déploient dans des cadres variés, des cloîtres monastiques aux jardins castraux, en passant par les vergers paysans et les enclos urbains. Leur conception est fortement influencée par les écrits théologiques et agronomiques médiévaux, qui en font non seulement des lieux de production et de repos, mais aussi des espaces symboliques où l’ordre divin se reflète dans l’agencement de la nature. Pour mieux comprendre l’émergence et la diffusion de ces jardins, il convient d’examiner leur contexte historique et géographique, en retraçant leurs origines, leurs modalités d’implantation et les influences religieuses qui ont façonné leur organisation.
Contexte historique
Dans les paysages médiévaux, les jardins tenaient une place fondamentale, qu’ils soient espaces de production nourricière, lieux de contemplation monastique ou symboles de prestige aristocratique. Leur évolution est indissociable des transformations sociales et culturelles qui marquèrent l’Occident médiéval. Héritiers des pratiques antiques, enrichis par les savoirs monastiques et diffusés à travers les grands foyers du pouvoir féodal, ils devinrent des éléments structurants de la société médiévale, à la croisée de l’économie, de la spiritualité et de l’aménagement territorial.
Le Moyen Âge hérita largement des traditions horticoles de l’Antiquité. Déjà sous Rome, les horti étaient omniprésents dans les villas aristocratiques comme dans les espaces publics, aménagés pour la culture des plantes médicinales et aromatiques. Pline l’Ancien, dans son Histoire naturelle, décrivait avec minutie ces jardins où se mêlaient la culture vivrière et l’esthétique, où l’eau, omniprésente, structurant les allées et les bassins, participait à l’organisation du paysage. L’effondrement de l’Empire romain marqua une transformation des modes de culture et de gestion des jardins, mais les connaissances botaniques et agronomiques ne disparurent pas totalement. Elles furent préservées et enrichies au sein des monastères, véritables foyers de conservation du savoir antique.
Avec la montée du monachisme à partir du VIe siècle, notamment sous l’impulsion des règles bénédictines, le jardin devint un élément central de la vie monastique. Le Capitulaire De Villis de Charlemagne, document normatif rédigé à la fin du VIIIe siècle, témoigne de cette importance et énumère avec précision les plantes qui devaient être cultivées dans les jardins impériaux et monastiques. L’Hortulus de Walafrid Strabo, moine du IXe siècle, apporte un éclairage supplémentaire sur la manière dont les religieux structuraient leurs espaces verts : il décrit des parterres ordonnés où se côtoient plantes médicinales, légumes et fleurs, dans un équilibre entre utilité et contemplation. À Cluny, Fleury ou encore Saint-Gall, les jardins cloîtrés étaient conçus à la fois comme lieux de méditation et espaces d’autosuffisance, répondant aux impératifs d’une vie réglée par la prière et le travail manuel.
Dès le XIIe siècle, l’essor des villes et des grands domaines seigneuriaux entraîna la diffusion des jardins hors du cadre monastique. Les châteaux s’entourèrent de jardins clos, qui répondaient à des besoins autant pratiques qu’esthétiques. Les jardins de plaisance, souvent décrits dans les romans courtois, étaient des espaces aménagés pour les promenades et les rencontres, bordés de treilles et parsemés de fontaines. L’iconographie du Roman de la Rose, illustrée par les enluminures du XVe siècle, témoigne de cet engouement pour les espaces végétalisés, où se mêlent nature domestiquée et symbolique de l’amour courtois. Dans les villes, la présence de jardins était plus discrète mais tout aussi essentielle : de petites parcelles, souvent adossées aux maisons, servaient à la culture maraîchère et aux simples nécessaires aux apothicaires.
Les jardins paysans, bien que moins documentés, constituaient un pilier de l’économie rurale. Leur organisation variait selon les régions, mais ils étaient généralement situés à proximité immédiate des habitations, clôturés par des haies vives ou des clayonnages afin de protéger les cultures des animaux errants. Des fouilles menées sur des sites désertés, comme celui de Dracy en Bourgogne, ont révélé des traces de murets en pierre sèche délimitant de petites parcelles enrichies par des apports de terre et de cendres. Ces indices archéologiques permettent d’affirmer que, loin d’être des espaces secondaires, ces jardins étaient entretenus avec soin et intégrés aux cycles agricoles médiévaux.
La religion joua un rôle structurant dans la conception et la symbolique des jardins médiévaux. L’image du hortus conclusus, inspirée du Cantique des Cantiques, influença profondément la représentation du jardin dans l’art et la littérature. Symbole de pureté et de perfection divine, le jardin clos devint un motif récurrent dans l’iconographie mariale, mais aussi dans les enluminures des livres d’heures, où il apparaissait comme un refuge idéal, protégé du tumulte extérieur. Les jardins des monastères cisterciens, souvent dépouillés et d’une grande sobriété, reflétaient cette vision spirituelle du monde végétal, contrastant avec les jardins fastueux des cours princières.
Le développement des villes et des échanges commerciaux au XIVe et XVe siècle favorisa l’introduction de nouvelles espèces végétales, souvent rapportées d’Orient à la suite des Croisades. Des plantes comme le citronnier, l’aubergine ou encore certaines variétés de roses furent progressivement acclimatées en Occident, enrichissant la palette horticole médiévale. Cette ouverture se traduisit également par l’essor de véritables traités de jardinage, tel le Traité d’Agriculture de Pierre de Crescens, rédigé au début du XIVe siècle, qui détaillait les méthodes de culture et d’entretien des vergers et jardins potagers.
Ainsi, les jardins médiévaux, loin d’être de simples espaces végétalisés, étaient au cœur des dynamiques sociales, économiques et spirituelles de leur temps. De l’héritage antique aux innovations monastiques, en passant par leur diffusion dans les châteaux et les villes, ils témoignent d’un savoir-faire complexe où se mêlent utilité, esthétique et symbolisme. Leur étude, enrichie par les avancées de l’archéologie et l’exploitation des sources textuelles, permet aujourd’hui d’en reconstituer les contours et de mieux comprendre leur rôle dans l’aménagement des paysages médiévaux.
Les jardins médiévaux étaient aussi des lieux chargés de symboles, reflétant une vision ordonnée et spirituelle du monde. Leur organisation ne relevait pas seulement de considérations pratiques, mais s’inscrivait dans une conception plus vaste, où l’harmonie du jardin résonnait avec l’ordre divin. Inspirés des textes sacrés et des traditions philosophiques, ces espaces clos prenaient la forme de microcosmes, incarnant tantôt l’image du Paradis perdu, tantôt celle du jardin céleste promis aux âmes vertueuses. Les formes géométriques, les nombres et la disposition des végétaux répondaient à un langage codifié, où chaque élément, de la structure des parterres aux espèces cultivées, portait en lui une signification profonde. Ce symbolisme s’exprimait notamment à travers le carré et ses multiples, évoquant les quatre Évangiles, les saisons ou les éléments naturels, mais aussi par le choix des plantes, investies de valeurs spirituelles précises. La présence de fontaines et de bassins, omniprésents dans les représentations iconographiques, traduisait cette quête de pureté et de régénérescence, faisant du jardin un espace sacré où se rejoignaient la nature et la foi.
01. Symbolisme et représentation du monde médiéval dans l’espace du jardin
Dans l’imaginaire médiéval, le jardin n’est pas qu’un simple espace de culture ou de détente. Il est une construction intellectuelle et spirituelle, un microcosme de l’ordre divin, où chaque élément possède une signification précise, où chaque ligne tracée est un reflet du cosmos. Loin d’être un simple lieu de travail ou d’agrément, le jardin médiéval s’inscrit dans une vision du monde où l’homme, la nature et Dieu entretiennent une relation triangulaire indissociable.
L’un des aspects fondamentaux de cette conception est l’enclos, qui définit le jardin à l’image du hortus conclusus, symbole marial par excellence. Ce jardin clos évoque le Paradis perdu, un éden miniature recréé par la main de l’homme pour retrouver, par l’ordre et la discipline, la perfection divine. Honorius d’Autun, dans sa Gemma animae, écrit ainsi que « le monastère est une image du Paradis, d’un paradis plus sûr que le paradis terrestre ». Cette comparaison entre le cloître et le Jardin d’Éden n’est pas une simple figure de style, mais une réalité architecturale et spirituelle : les moines, en cultivant et en ordonnant la terre, participent à une œuvre de rédemption, rétablissant l’harmonie originelle de la Création.
Cette volonté d’ordre et de symétrie s’incarne dans l’usage du carré et de ses subdivisions en quatre parties égales, une structure que l’on retrouve dans les cloîtres monastiques et les jardins princiers. Ce découpage n’est pas arbitraire : il renvoie aux quatre fleuves du Paradis décrits dans la Genèse (Pishon, Guihon, Tigre et Euphrate), mais aussi aux quatre Évangiles, aux quatre saisons et aux quatre éléments fondamentaux du monde naturel selon la pensée médiévale. L’exemple le plus emblématique de cette organisation reste le plan du monastère de Saint-Gall, rédigé au IXe siècle, où chaque espace est soigneusement défini et intégré à une vision plus large de l’univers monastique. Le cloître, au centre, est lui-même un carré parfait, organisé autour d’un jardin symbolique où les plantes, l’eau et l’architecture s’unissent pour créer un espace sacré.
Les plantes qui peuplent ces jardins ne sont jamais choisies au hasard. Leur présence répond à une double fonction, à la fois médicinale et spirituelle. L’hysope, mentionnée dans l’Exode et dans le Psaume 50 ("Asperges me hyssopo, et mundabor"), est utilisée pour les rituels de purification et traduit une quête de pureté intérieure. La sauge, dont l’étymologie latine salvia signifie « celle qui sauve », est non seulement un remède prisé dans la pharmacopée médiévale, mais aussi une plante aux vertus symboliques liées à la protection et au salut. Certaines plantes, comme la rose et le lys, sont directement rattachées à la Vierge Marie : la rose rouge symbolise son amour et son sacrifice, tandis que le lys blanc représente sa pureté immaculée. Cette association se retrouve dans la littérature religieuse et iconographique, notamment dans les enluminures des Livres d’Heures, où la Vierge est fréquemment représentée dans un hortus conclusus empli de ces fleurs.
Dans ces jardins, les fontaines et bassins occupent une place tout aussi essentielle. L’eau y est une présence à la fois matérielle et mystique, source de vie et de purification. Guillaume Durand, dans son Rationale divinorum officiorum, décrit le cloître comme un espace sacré où la fontaine centrale rappelle les quatre fleuves du Paradis, mais aussi la grâce divine qui irrigue l’âme du croyant. Ce symbolisme est particulièrement visible dans les cloîtres cisterciens, où les bassins sont souvent situés au centre de la cour, renforçant l’idée d’un axe spirituel autour duquel s’organise la vie monastique.
À travers cette structuration, le jardin médiéval devient bien plus qu’un simple lieu d’exploitation ou de contemplation : il est une miniature du cosmos, un espace ordonné qui reflète l’ordre divin, où chaque plante, chaque pierre, chaque goutte d’eau participe à une vision du monde où le sacré et le terrestre ne font qu’un.
Au-delà de sa dimension symbolique et spirituelle, le jardin médiéval est avant tout un espace fonctionnel répondant aux besoins essentiels de la vie quotidienne. Monastères, châteaux et demeures seigneuriales intègrent des jardins dont l’organisation et les usages varient selon leur vocation. Si le hortus conclusus reflète une vision ordonnée du monde, il est aussi un lieu de travail où chaque plante est cultivée pour une finalité précise. Du jardin médicinal (herbularius), véritable laboratoire de la pharmacopée monastique, au potager (hortus), garant de l’autosuffisance alimentaire, en passant par les espaces de détente et d’agrément (viridarium), ces jardins traduisent une approche pragmatique où l’exploitation des ressources naturelles se conjugue avec un savoir ancestral. À cela s’ajoute l’usage des plantes tinctoriales et utilitaires, indispensables à l’artisanat et aux industries textiles médiévales. C’est donc dans une logique d’équilibre entre nécessité et esthétique, entre survie et raffinement, que s’organise le jardin médiéval dans toute sa diversité.
02. Fonctionnalités et usages pratiques des jardins médiévaux
L’espace monastique et seigneurial du Moyen Âge n’était pas uniquement un lieu de contemplation ou de prière, mais un véritable écosystème organisé autour d’une diversité de jardins, chacun répondant à des fonctions spécifiques. Depuis le jardin médicinal des monastères, consacré à la culture des simples, jusqu’aux potagers nourriciers et aux jardins d’agrément des élites, ces espaces végétaux participaient à l’organisation économique et sociale de la société médiévale. En parallèle, l’usage des plantes tinctoriales et utilitaires permettait d’assurer la production de matières premières essentielles à la teinture et à l’industrie textile.
Le jardin médicinal, ou herbularius, occupait une place fondamentale dans la pharmacopée médiévale. Présent au sein des monastères, il servait à la culture des plantes destinées à la préparation des remèdes et potions prescrits selon les connaissances héritées de l’Antiquité et enrichies par les savoirs arabes et byzantins. Les moines botanistes, héritiers des prescriptions de Dioscoride et de Pline l’Ancien, consignaiennt leurs observations dans des traités tels que le De materia medica ou le Tacuinum Sanitatis d’Ibn Butlân. Dans le Capitulare de Villis, Charlemagne établit une liste de plantes à cultiver dans les domaines impériaux, parmi lesquelles la sauge, la rue, la jusquiame et la valériane, toutes reconnues pour leurs vertus médicinales. L’abbesse Hildegarde de Bingen, au XIIe siècle, dans son Physica, recommandait l’usage de la mélisse pour apaiser les esprits et du millepertuis pour soigner les blessures. Les moines, dans l’enceinte protégée de leurs cloîtres, cultivaient ainsi ces plantes précieuses et en tiraient baumes, onguents et décoctions destinés aux soins des malades accueillis dans les infirmeries attenantes aux abbayes.
Le jardin potager, ou hortus, répondait quant à lui aux impératifs de subsistance. Loin d’être un espace négligeable, il constituait la pierre angulaire de l’économie vivrière monastique et seigneuriale. Dans les abbayes, il fournissait aux religieux une alimentation principalement végétarienne, en accord avec la règle bénédictine. On y cultivait des légumes adaptés au climat et aux saisons : choux, navets, fèves, pois et poireaux occupaient des parcelles soigneusement entretenues, irriguées grâce à un ingénieux réseau de canaux. Les connaissances agronomiques, conservées dans des polyptyques et des cartulaires monastiques, témoignent de techniques de rotation des cultures et d’enrichissement des sols par le compostage. L’hortus se prolongeait souvent par un verger où poussaient pommiers, poiriers et cerisiers, dont les fruits étaient consommés frais ou conservés sous forme de compotes et de cidres. Dans les seigneuries, la gestion de ces potagers revenait aux vilains, dont le labeur alimentait les cuisines des châteaux, où les légumes venaient compléter une alimentation largement carnée. Loin de se limiter à un simple espace de culture, ces potagers étaient des lieux d’expérimentation, où les moines acclimataient des variétés nouvelles rapportées des croisades ou des comptoirs marchands méditerranéens.
Si le herbularius et l’hortus répondaient à des nécessités médicales et alimentaires, le viridarium, ou jardin d’agrément, relevait d’une toute autre fonction. Situé au cœur des résidences seigneuriales ou princières, il offrait un cadre propice à la contemplation et à la détente. Héritier des horti antiques, il était conçu comme un espace clos, structuré par des allées bordées de buis et de charmilles, où les dames et chevaliers venaient deviser à l’ombre des tonnelles recouvertes de rosiers grimpants. Le Roman de la Rose en donne une représentation idéalisée, où le jardin devient le théâtre de l’amour courtois. Dans les palais royaux, comme à la cour des Plantagenêt, ces jardins étaient agrémentés de fontaines et de bassins, symboles de pureté et de raffinement. On y trouvait des plantations de fleurs aux senteurs enivrantes, telles que la lavande, le lys ou le jasmin, qui embaumaient l’air et renforçaient l’atmosphère de sérénité recherchée par leurs propriétaires. À l’inverse des jardins monastiques, fondés sur une organisation fonctionnelle et utilitaire, les viridaria étaient des lieux de loisir, témoignant du prestige et de l’art de vivre des classes aristocratiques.
L’usage des plantes ne se limitait pas à l’alimentation ou à la médecine : certaines espèces étaient également cultivées pour la production de teintures et de fibres textiles, indispensables aux activités artisanales et marchandes. Parmi elles, la garance, dont les racines fournissaient une teinte rouge vif, était prisée dans la fabrication des étoffes précieuses. La guède, aussi appelée pastel, servait à obtenir des bleus intenses, utilisés notamment dans les draperies du Midi, tandis que la gaude procurait une teinte jaune lumineuse. Ces plantes, souvent cultivées dans des parcelles dédiées au sein des domaines seigneuriaux, étaient soumises à des réglementations strictes, comme en attestent les ordonnances royales sur le commerce des teintures au XIIIe siècle. Le chanvre et le lin, quant à eux, constituaient des ressources textiles essentielles : le premier était employé dans la confection des cordages et des voiles de navires, tandis que le second servait à la production des chemises et des draps fins prisés des élites. Les chartes des villes drapières, comme celles de Troyes ou de Gand, mentionnent ces cultures comme une source de richesse, preuve de leur importance dans l’économie médiévale.
À travers ces différents jardins et cultures spécialisées, le Moyen Âge révèle une organisation des espaces verts qui dépasse la simple agriculture. Chaque plantation, chaque parcelle avait un rôle précis, qu’il s’agisse de nourrir, soigner, embellir ou produire des matières premières essentielles. Les monastères, seigneuries et cités médiévales ont ainsi développé un savoir-faire horticole et botanique qui a perduré bien au-delà du Moyen Âge, influençant durablement les pratiques agricoles et médicales des siècles suivants.
Les jardins médiévaux répondaient à une organisation précise, reflet des structures sociales et économiques de l’époque. Qu’ils soient monastiques, seigneuriaux ou paysans, ils obéissaient à des logiques spatiales et fonctionnelles bien définies, témoignant de la diversité des usages et des savoirs horticoles transmis au fil des siècles. Tandis que les jardins monastiques s’imposaient comme des lieux d’étude et de conservation des connaissances botaniques, les jardins seigneuriaux et princiers affichaient une ambition ostentatoire, mettant en scène le prestige et l’influence de leurs propriétaires. À une autre échelle, les jardins urbains et paysans, bien que plus modestes, assuraient une fonction essentielle dans la vie quotidienne, entre culture vivrière et utilitaire. Cette typologie des jardins, fondée sur des logiques de statut et d’usage, révèle ainsi une organisation réfléchie qui mérite d’être examinée de plus près.
03. Organisation et typologie des jardins médiévaux
Dans l’Europe médiévale, le jardin est un espace structuré, reflet des besoins matériels, spirituels et sociaux de la société qui l’entretient. Qu’il soit lié à un monastère, intégré à une résidence seigneuriale ou aménagé dans un cadre urbain ou paysan, il répond à des fonctions précises qui dépassent la simple culture des plantes. Loin d’être un simple espace agricole, le jardin médiéval s’inscrit dans une organisation pensée, influencée par des traditions anciennes, des échanges culturels et une adaptation constante aux réalités climatiques et géographiques.
Les jardins monastiques, héritiers d’une tradition antique transmise par les textes de Pline et de Dioscoride, jouent un rôle central dans la conservation et la transmission du savoir botanique. À l’image du célèbre plan de l’abbaye de Saint-Gall du IXe siècle, leur organisation repose sur une division fonctionnelle rigoureuse, répondant aux besoins alimentaires, médicinaux et spirituels de la communauté religieuse. L’hortus, réservé aux légumes et aux plantes potagères, jouxte l’herbularius, où sont cultivées les simples médicinales nécessaires aux soins dispensés aux malades. Plus loin, le viridarium, verger aux essences variées, offre des fruits indispensables à l’alimentation des moines et à la confection d’onguents et de potions. Cette organisation est dictée par des impératifs pratiques autant que par des considérations spirituelles. Les jardins monastiques sont des lieux de méditation autant que de travail, et chaque plante y trouve sa place en fonction de ses propriétés, mais aussi de sa symbolique religieuse.
L’abbaye de Cluny, l’un des foyers intellectuels les plus influents du Moyen Âge, consacre une part essentielle de son domaine à l’entretien de jardins, où les moines copistes consignent minutieusement les connaissances botaniques accumulées au fil des siècles. Dans le scriptorium, les traités médicaux et les herbiers enrichis d’illustrations servent de base à l’enseignement des moines herboristes. L’Hortus Deliciarum d’Hildegarde de Bingen, rédigé au XIIe siècle, témoigne de cette transmission du savoir en détaillant les vertus des plantes cultivées dans les monastères. Le climat et la nature des sols influencent le choix des cultures : en Provence, les monastères privilégient la vigne et l’olivier, tandis que dans le nord de la France, les moines cultivent davantage les légumes racines et les céréales adaptées aux hivers rigoureux. Face aux contraintes environnementales, l’ingéniosité des ordres monastiques se manifeste par la création de systèmes de drainage et d’irrigation permettant d’optimiser les rendements.
À quelques lieues des abbayes, les châteaux seigneuriaux et princiers disposent de jardins aux fonctions bien distinctes. Contrairement aux jardins monastiques, où chaque plante a un usage déterminé, les jardins seigneuriaux s’attachent autant à l’utile qu’à l’esthétique. Ils reflètent le pouvoir et le prestige de leurs propriétaires et servent de cadre aux loisirs et aux représentations politiques. Aux XIIe et XIIIe siècles, les seigneurs conçoivent des espaces clos, agrémentés de treillages, de pergolas et de bassins d’eau, où ils se promènent et reçoivent leurs invités. Le jardin devient alors un prolongement du château, un espace de raffinement où la nature est maîtrisée.
Le château d’Amboise illustre cette évolution, notamment à partir du règne de Charles VIII, lorsqu’il introduit les premiers jardins en terrasses inspirés des modèles italiens. Pacello de Mercogliano, jardinier napolitain invité à la cour de France, y conçoit un agencement symétrique intégrant fontaines et parterres fleuris, prémices de ce qui deviendra le jardin à la française. Avant cette influence italienne, les jardins princiers médiévaux s’inspirent encore du modèle clos, héritier du hortus conclusus monastique, où la végétation est soigneusement organisée selon des principes hérités de l’Antiquité et des échanges culturels avec le monde islamique. Les croisades favorisent l’introduction de nouvelles espèces végétales et de techniques d’aménagement inspirées des jardins persans et andalous, où l’eau occupe une place centrale. À Ripaille, résidence des ducs de Savoie, les bassins d’eau et les galeries couvertes de plantes grimpantes témoignent de cette influence.
Loin du faste des jardins princiers, les jardins urbains et paysans obéissent à des impératifs avant tout fonctionnels. Dans les villes médiévales, les petits enclos cultivés en périphérie des habitations permettent aux citadins de produire une part de leur alimentation, tout en approvisionnant les marchés locaux. À Paris, les réglementations municipales encadrent l’usage de ces jardins, certains étant réservés aux corporations de marchands d’herbes et de légumes, tandis que d’autres sont entretenus par des institutions ecclésiastiques. Les archives du XIVe siècle mentionnent des taxes spécifiques sur l’usage de l’eau pour l’irrigation des jardins intra-muros, soulignant leur importance dans l’économie locale.
Dans les campagnes, les paysans exploitent de petites parcelles clôturées, où ils cultivent des légumes, des céréales et des plantes médicinales. L’organisation de ces jardins varie en fonction des régimes fonciers : certains sont la propriété des seigneurs, qui concèdent leur usage en échange d’une redevance, tandis que d’autres sont exploités en commun par les habitants d’un village. La rotation des cultures, pratiquée dès le XIe siècle, permet d’assurer une production continue et d’éviter l’appauvrissement des sols. Les monastères jouent un rôle essentiel dans la diffusion des techniques agricoles, notamment par la sélection des semences et l’amélioration des méthodes de culture.
Les jardins médiévaux, qu’ils soient monastiques, seigneuriaux ou paysans, révèlent ainsi une diversité d’usages et de formes, influencée par des considérations économiques, climatiques et culturelles. Ils sont à la fois des lieux de production, de savoir et de représentation, témoins des dynamiques sociales et intellectuelles de leur époque. Leur évolution, du cloître monastique aux jardins princiers inspirés de l’Italie, illustre la transformation progressive des conceptions médiévales de l’espace et du paysage.
Les jardins médiévaux ont laissé une empreinte durable sur les conceptions paysagères qui leur ont succédé. À la Renaissance, l’influence des modèles italiens transforme l’organisation des jardins, qui s’ouvrent à de nouvelles perspectives et abandonnent peu à peu la structure cloisonnée héritée des monastères et des châteaux féodaux. Pourtant, nombre de principes médiévaux perdurent, que ce soit dans la sélection des plantes, l’agencement des espaces ou l’exploitation des ressources naturelles. Aujourd’hui, cet héritage se retrouve dans les restaurations historiques, les jardins d’inspiration médiévale et même dans certaines pratiques contemporaines de jardinage écologique et de permaculture. La redécouverte et la valorisation de ces espaces, à travers des initiatives de conservation et de reconstitution, témoignent de leur importance dans le patrimoine culturel français et de leur capacité à inspirer de nouvelles formes de relation entre l’homme et la nature.
04. Héritage et influences sur les jardins post-médiévaux
À la croisée des influences monastiques et seigneuriales, le jardin médiéval a traversé les siècles pour évoluer vers des formes plus ouvertes et décoratives à la Renaissance. Loin de disparaître, son empreinte se retrouve encore aujourd’hui dans la conception des jardins contemporains, qu’il s’agisse des restaurations patrimoniales ou des mouvements écologiques qui s’inspirent de ses principes d’organisation et de biodiversité.
Avec la Renaissance, une transformation fondamentale s’opère dans l’art des jardins. Alors que le jardin médiéval, cloîtré et fonctionnel, servait essentiellement des buts médicinaux, nourriciers et spirituels, le jardin renaissant devient un espace de mise en scène du pouvoir et du raffinement. Sous l’influence des traités italiens, notamment ceux de Leon Battista Alberti et de Pietro de’ Crescenzi, l’agencement se libère des structures fermées pour privilégier une composition plus symétrique et intégrée aux perspectives du palais ou du château. Cette évolution se matérialise dans les jardins royaux de François Ier, où l’on cherche à magnifier le paysage par de longues allées bordées d’arbres fruitiers et d’ornements sculptés. À Fontainebleau, les lettres de l’humaniste Blaise de Vigenère évoquent un jardin où "la nature se dompte en figures, en bassins et en bosquets, pour donner à voir ce que la terre peut offrir de plus ordonné" (1580). Pourtant, malgré ce goût pour les grandes perspectives et les jeux d’eau, le jardin Renaissance conserve certains héritages médiévaux : l’usage des plantes médicinales, la culture en carré héritée des cloîtres et, surtout, une approche de l’espace où chaque élément végétal répond à un usage précis, qu’il soit ornemental ou utilitaire.
Si les jardins médiévaux structurés se transforment à l’époque moderne, ils ne disparaissent pas totalement. Leur influence se retrouve dans les jardins à la française du Grand Siècle, où l’idée de cloisonnement persiste à travers les compartiments végétaux et les parterres géométriques de Le Nôtre. Dans les domaines princiers, on conserve encore des carrés de simples et des vergers en espalier, témoins de l’ancienne tradition du hortus conclusus. Des sources d’archives mentionnent ainsi, sous Louis XIV, des "parcelles réservées aux plantes exotiques et médicinales, entretenues avec soin dans l’enclos du château de Versailles" (Archives nationales, F/19/7734). Ces héritages médiévaux réapparaissent aussi sous une autre forme avec les jardins paysagers du XVIIIe siècle, où le goût pour les fabriques gothiques et les ruines rappelle une fascination romantique pour le passé médiéval.
Aujourd’hui, les inspirations médiévales connaissent un regain d’intérêt à travers diverses formes de restauration et de reconstitution. Les jardins monastiques, longtemps négligés, font l’objet de projets de conservation, notamment dans les abbayes où les plans d’origine sont minutieusement réinterprétés à partir des textes d’époque. À l’abbaye de Saint-André-en-Royans, les reconstitutions s’appuient sur les descriptions du Capitulaire De Villis de Charlemagne, qui liste les espèces végétales cultivées dans les domaines monastiques du IXe siècle. De même, le jardin de l’abbaye de Royaumont, reconstitué au début des années 2000, reprend les principes d’organisation des jardins médiévaux avec une séparation stricte entre les carrés de simples, le potager et les allées de circulation. Cette dynamique de préservation ne se limite pas aux lieux religieux. Les jardins seigneuriaux, comme ceux du château du Rivau, ont également été recréés en respectant les principes esthétiques et botaniques de la fin du Moyen Âge, intégrant des plantes tinctoriales, des haies de charmilles et des topiaires rappelant les enluminures du Roman de la Rose.
Outre les restaurations patrimoniales, les principes des jardins médiévaux trouvent un écho particulier dans les courants écologiques contemporains. La permaculture, en particulier, s’inspire de l’organisation en polyculture des jardins monastiques, où la diversité végétale garantissait une meilleure résilience aux aléas climatiques. On retrouve cette logique dans certains jardins urbains où sont réintroduites des techniques ancestrales, comme le mulching à base de paille ou les associations de plantes inspirées des carrés de simples. Plusieurs projets en France, à l’image du Jardin des Simples du Puy-du-Fou ou des initiatives en agroécologie du Bec-Hellouin, revendiquent ainsi un retour aux pratiques inspirées du Moyen Âge, en mettant en avant des méthodes respectueuses des sols et de la biodiversité.
En France aujourd’hui, la préservation des jardins médiévaux s’accompagne d’une valorisation patrimoniale accrue. De nombreux sites classés intègrent désormais ces espaces dans des circuits de visite, mettant en avant leur richesse historique et botanique. Le Festival des Murs à Pêches à Montreuil, qui célèbre chaque année l’héritage horticole de ces vergers clos, témoigne de cet intérêt renouvelé pour les paysages cultivés du passé. L’inscription en 2023 de l’art de l’espalier au Patrimoine Culturel Immatériel de la France confirme cette tendance à réhabiliter les savoir-faire ancestraux en lien avec l’histoire des jardins. Cette démarche ne se limite pas à un souci de préservation historique ; elle reflète aussi un changement de paradigme dans notre rapport à la nature et au paysage, où les leçons du passé offrent des solutions adaptées aux défis contemporains de l’agriculture et de l’aménagement du territoire.
Loin d’être figés dans le temps, les jardins médiévaux continuent ainsi d’inspirer des formes nouvelles, oscillant entre la fidélité aux traditions et leur adaptation aux préoccupations écologiques actuelles. Que ce soit à travers les reconstitutions patrimoniales ou les approches durables en permaculture, leur empreinte reste visible, témoignant d’un dialogue constant entre héritage et innovation.
Ainsi, les jardins médiévaux, continuent d’exercer une influence durable sur notre rapport à la nature et aux espaces cultivés. Leur organisation rigoureuse, dictée par des nécessités aussi bien pratiques que spirituelles, a traversé les siècles pour se réinventer sous des formes variées. Aujourd’hui, entre préservation patrimoniale et adaptations aux enjeux contemporains, ils témoignent d’une quête intemporelle d’harmonie entre l’homme et son environnement. Cette continuité invite à une réflexion plus large sur la manière dont ces jardins, tout en conservant leur essence, s’intègrent dans les pratiques actuelles et les défis de demain.
Conclusion
Les jardins médiévaux n’étaient pas de simples espaces de culture et de détente, mais des lieux où s’articulaient des enjeux économiques, religieux et sociaux, inscrivant la nature dans un cadre ordonné et structuré. Leur organisation, issue d’un héritage antique enrichi par les apports monastiques et seigneuriaux, témoigne d’une volonté de maîtrise du vivant qui dépassait la seule nécessité agricole. À travers l’Occident médiéval, ces jardins répondaient à des impératifs précis, conciliant production vivrière, usages médicinaux et représentation du pouvoir, tout en étant porteurs d’une forte charge symbolique et spirituelle.
Dès le haut Moyen Âge, les monastères ont joué un rôle fondamental dans la préservation et la transmission des savoirs botaniques. En 812, Charlemagne, par le Capitulare de Villis, établit une liste de plantes devant être cultivées sur les domaines impériaux et monastiques, instituant ainsi une première régulation officielle de l’agriculture médiévale. Ce texte, qui recense près de soixante-dix espèces végétales, incluait des plantes alimentaires, médicinales et ornementales, illustrant l’organisation méthodique de ces espaces. À l’abbaye de Saint-Gall, au IXe siècle, un plan d’ensemble détaillé témoigne de cette structuration rigoureuse : un cloître central jouxté d’un herbularius réservé aux plantes médicinales, un hortus dédié aux légumes, et un verger à l’écart, où l’on cultivait pommiers, poiriers et cerisiers. L’organisation spatiale de ces jardins s’intégrait pleinement dans la vie monastique, répondant à la nécessité d’autosuffisance tout en incarnant une vision du monde où l’ordre divin se reflétait dans la maîtrise du végétal.
Dans les demeures seigneuriales et princières, les jardins revêtaient une fonction différente, souvent associée à la démonstration du prestige et de la puissance. Le Roman de la Rose, composé par Guillaume de Lorris au XIIIe siècle, décrit un jardin clos où la nature est aménagée à des fins esthétiques et symboliques, évoquant l’espace de sociabilité et de courtoisie propre aux résidences aristocratiques. Les sources archivistiques attestent également de cette dimension politique du jardin. En 1364, le roi Charles V ordonne l’aménagement de jardins à son château de Vincennes, insistant sur l’importance des plantations d’arbres fruitiers et la construction de pavillons d’agrément. Ce goût pour la nature maîtrisée se retrouve dans les grandes cours princières européennes, où les jardins deviennent des lieux de plaisir et de représentation, comme en témoigne la célèbre description du jardin du palais des ducs de Bourgogne à Hesdin en 1432, où Jean sans Peur fit installer des mécanismes hydrauliques et des fontaines sculptées.
Les jardins médiévaux ne se cantonnaient cependant pas aux seules sphères religieuses et seigneuriales. En milieu urbain, les documents cadastraux du XIVe siècle indiquent que chaque maison possédait un petit hortus parvus, souvent situé à l’arrière de l’habitation, où étaient cultivées des plantes alimentaires et médicinales. À Paris, le prévôt des marchands réglementa en 1472 l’entretien de ces espaces, précisant que les parcelles situées le long des remparts devaient être réservées aux cultures vivrières afin d’assurer l’approvisionnement en cas de siège. Ces jardins, bien que plus modestes, jouaient ainsi un rôle crucial dans l’organisation des villes médiévales, où la culture maraîchère était une nécessité pour la survie des populations.
Au-delà de leur diversité fonctionnelle, ces jardins étaient aussi porteurs d’une forte charge symbolique. La représentation du hortus conclusus, associée à la Vierge Marie, en est l’un des exemples les plus marquants. Dans les enluminures du Bréviaire de Belleville (1323-1326), la Vierge est représentée dans un jardin clos abondamment fleuri, illustrant l’idée d’un espace préservé du monde extérieur, où se déploie un univers idéal. L’association entre le jardin et le sacré se retrouve également dans les pratiques funéraires médiévales, certains cimetières étant aménagés sous forme de vergers, en écho aux représentations bibliques du Paradis perdu.
Si la fin du Moyen Âge voit émerger de nouvelles conceptions de l’aménagement paysager sous l’influence italienne, l’héritage des jardins médiévaux ne disparaît pas pour autant. Nombre de principes de structuration et de gestion des cultures perdurent à la Renaissance, comme en témoigne l’aménagement des premiers jardins royaux en France. Le château d’Amboise, sous Charles VIII, introduit les premiers jardins en terrasses inspirés des modèles italiens, mais conserve encore des espaces clos et des vergers hérités de la tradition médiévale.
Aujourd’hui, ces jardins restent une source d’inspiration majeure, tant pour les historiens que pour les paysagistes et les praticiens du jardinage écologique. Les initiatives de reconstitution menées à l’abbaye de Royaumont ou au château du Rivau s’appuient sur les sources textuelles et iconographiques médiévales pour redonner vie à ces espaces historiques. Par ailleurs, les principes de polyculture et de respect de la biodiversité qui régissaient les jardins monastiques trouvent un écho dans les pratiques contemporaines de permaculture, où l’association des espèces et la gestion raisonnée des ressources rappellent les méthodes utilisées par les moines du Moyen Âge.
Loin d’être de simples vestiges du passé, les jardins médiévaux s’inscrivent ainsi dans une continuité, témoignant de leur rôle fondamental dans l’histoire paysagère et agricole. Entre conservation patrimoniale et adaptation aux enjeux environnementaux actuels, ils illustrent la permanence d’une conception du jardin où la nature, loin d’être livrée au hasard, est pensée, aménagée et intégrée dans un cadre structuré, qu’il soit religieux, seigneurial ou urbain. Loin d’une approche purement esthétique ou utilitaire, ils reflètent une organisation savante, façonnée par des siècles de savoirs et d’expérimentations, et continuent d’éclairer notre compréhension du rapport entre l’homme et son environnement.








Sources bibliographiques (Format APA 7e édition)
Baridon, M. (1998). Les Jardins. Paysagistes, jardiniers, poètes. Paris : Robert Laffont.
Bec, P. (1979). Anthologie des troubadours. Paris : Union Générale d'Éditions.
Beck, B. (2000). Jardin monastique, jardin mystique. Ordonnance et signification des jardins monastiques médiévaux. Revue d’histoire de la pharmacie, 88(327), 377-394.
Bouet, P. (2012). Les jardins monastiques en Occident : Histoire et fonctions. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.
Boutier, M. (2005). Paysages et jardins au Moyen Âge. Paris : Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.
Dauphiné, J. (2000). Du paradis terrestre. Dans Vergers et jardins dans l’univers médiéval (pp. 89-96). Aix-en-Provence : Presses Universitaires de Provence.
Deluz, C. (2000). Le jardin médiéval, lieu d’intimité. Dans Vergers et jardins dans l’univers médiéval (pp. 97-107). Aix-en-Provence : Presses Universitaires de Provence.
Duby, G. (1964). L'économie rurale dans l'Occident médiéval. Journal des savants, 1(1), 21-46.
Duby, G. (1980). Saint Bernard et l’esprit cistercien. Paris : Flammarion.
Duby, G. (1983). L’art cistercien. Paris : Flammarion.
Grodecki, L. (1981). Les jardins médiévaux dans l’art gothique. Paris : Éditions du CNRS.
Higounet-Nadal, A. (2000). Les jardins urbains dans la France médiévale. Dans Vergers et jardins dans l’univers médiéval (pp. 115-144). Toulouse : Presses Universitaires du Midi.
Kleindienst, T. (1990). Les jardins monastiques et leur rôle dans l’économie médiévale. Thèse de doctorat, Université Paris-Sorbonne.
Le Dantec, J.-P. (2002). Le Roman des Jardins. Paris : Seuil.
Meyer, P. (1973). The Medieval Monastic Garden. Gesta, 12, 57-72.
Mosser, M. (2000). Reconstitution et imagination des jardins médiévaux dans les études contemporaines. Revue de l’art, 127(4), 25-42.
Pastoureau, M. (2013). Vert, histoire d'une couleur. Paris : Seuil.
Paul-Sehl, M. (1980). Recherches sur le jardin médiéval. Thèse inédite, École Pratique des Hautes Études, Paris.
Planchon, V. (2010). Le jardin clos au Moyen Âge : Environnement, production et imaginaire. Tours : Presses Universitaires François-Rabelais.
Salet, F. (1961). Les jardins des abbayes cisterciennes et leur organisation. Congrès archéologique de France, 119e session. Paris : Société française d’archéologie.
Schapiro, M. (1977). On the Aesthetic Attitude in Romanesque Art. New York : George Braziller.
Sodigné-Costes, G. (1990). Les simples et les jardins. Dans Vergers et jardins dans l’univers médiéval. Aix-en-Provence : Presses Universitaires de Provence.
Vigneron, F. (2000). Le jardin « médiéval » du musée national du Moyen Âge à Paris. Fantasmagories du Moyen Âge. Presses Universitaires de Provence, 219-227.
Zech-Matterne, V., Derreumaux, M., & Preiss, S. (2008). Production et utilisation des plantes tinctoriales et textiles du Moyen Âge en France du Nord. Les nouvelles de l’archéologie, 112, 9-17.
Sources non bibliographiques (Manuscrits, sources historiques et sites internet)
Manuscrits et documents historiques
Charlemagne. (IXe siècle). Capitulare De Villis.
Crescenzi, P. de. (1305). Liber Ruralium Commodorum. Manuscrits médiévaux, Bibliothèque nationale de France.
Dioscoride. (vers 60 ap. J.-C.). De materia medica.
Avicenne. (1025). Le Canon de la médecine. Manuscrit médiéval.
Hildegarde de Bingen. (XIIe siècle). Physica. Traduction et édition moderne : Mabillon, J. (Ed.). (2003). Paris : Les Belles Lettres.
La Quintinie, J.-B. (1690). Instruction pour les jardins fruitiers et potagers. Paris : Imprimerie Royale.
Sources numériques et sites internet
OpenEdition. Vergers et jardins dans l’univers médiéval. Presses Universitaires de Provence. https://books.openedition.org/pup/2974
Persée. Les jardins au Moyen Âge : du XIe au début du XIVe siècle. Cahiers de Civilisation Médiévale, 46(184), 387-412. https://www.persee.fr/doc/ccmed_0007-9731_2003_num_46_184_2868
Gallica. Documents sur les jardins monastiques médiévaux. Bibliothèque nationale de France. https://gallica.bnf.fr
ENS Lyon. Le jardin médiéval. https://acces.ens-lyon.fr/acces/logiciels/e-librairie/biodiversite/le-jardin-medieval
Tourisme Troyes Champagne. Les jardins médiévaux de Troyes. https://www.troyeslachampagne.com
Tourisme93. Les murs à pêches de Montreuil. https://www.tourisme93.com
GLOSSAIRE GLOBAL
A
Acanthe : Plante dont les feuilles stylisées sont utilisées dans l’ornementation architecturale médiévale.
Agréage : Action de préparer le sol pour la culture dans un jardin médiéval.
Agronomie médiévale : Ensemble des techniques agricoles employées au Moyen Âge, incluant la rotation des cultures et l’usage d’engrais naturels.
Allégorie : Représentation d’une idée abstraite sous une forme concrète, courante dans l’art médiéval.
Anagogie : Interprétation spirituelle visant à dégager un sens divin des éléments du monde matériel.
Apothicaires : Spécialistes médiévaux des remèdes à base de plantes médicinales.
Arboriculture : Culture des arbres fruitiers et ornementaux dans les jardins médiévaux.
Archéo-botanique : Étude des restes végétaux anciens pour comprendre les pratiques agricoles historiques.
Ars topiaria : Art de la taille décorative des arbres et arbustes dans les jardins antiques et médiévaux.
Autosuffisance alimentaire : Capacité d’un domaine à produire ses propres denrées.
B
Bassin d’agrément : Élément décoratif des jardins princiers et aristocratiques, souvent alimenté en eau courante.
Bastide : Ville nouvelle du XIIIe siècle intégrant des espaces de jardins pour assurer l’autosuffisance.
Benedictins : Ordre monastique influençant l’organisation des jardins monastiques.
Brassage : Technique médiévale de fabrication de la bière utilisant des céréales issues des jardins monastiques.
Biodiversité cultivée : Diversité des variétés de plantes domestiquées dans un espace horticole.
C
Capitulare de Villis : Ordonnance de Charlemagne réglementant l’organisation des jardins impériaux et monastiques.
Carré de simples : Espace structuré pour la culture de plantes médicinales dans les monastères.
Cartulaire : Recueil médiéval de chartes administratives mentionnant parfois des jardins et terres cultivées.
Cens : Redevance annuelle payée pour l’exploitation de terres ou de jardins.
Château du Rivau : Domaine recréant des jardins selon les principes médiévaux.
Cisterciens : Ordre monastique connu pour ses jardins épurés et fonctionnels.
Cloître : Cour intérieure d’un monastère, souvent agrémentée d’un jardin.
Clayonnage : Clôture en branches entrelacées protégeant les espaces cultivés.
Cosmologie médiévale : Conception chrétienne du monde où le jardin symbolise un microcosme divin.
Courtil : Petit jardin urbain ou rural, destiné à la culture potagère et médicinale.
Cultivar : Variété végétale sélectionnée pour ses caractéristiques spécifiques.
D
Déduit (Jardin de) : Jardin courtois symbolisant le raffinement et le plaisir, notamment dans le Roman de la Rose.
Droit de banalité : Obligation de recourir aux installations seigneuriales influençant la gestion des jardins.
E
Éden (Jardin d’) : Référence biblique influençant la conception spirituelle des jardins médiévaux.
Évangiles (quatre) : Symbolique chrétienne influençant la structure quadripartite des jardins.
F
Fontaine sacrée : Élément central des jardins médiévaux, servant à l’irrigation et à la symbolique religieuse.
Fontaine de vie : Motif iconographique et architectural associé à la purification spirituelle.
G
Gaignage : Ensemble des terres attachées à un domaine seigneurial pour l’exploitation agricole.
Garance (Rubia tinctorum) : Plante tinctoriale utilisée pour obtenir la teinture rouge.
Genèse : Livre biblique influençant la conception théologique des jardins médiévaux.
Guède (Isatis tinctoria) : Plante tinctoriale produisant un bleu caractéristique.
H
Herbularius : Jardin médicinal des monastères destiné à la pharmacopée.
Hortus : Jardin potager monastique pour la culture des légumes et plantes alimentaires.
Hortus conclusus : Jardin clos souvent associé à la Vierge Marie, symbolisant la pureté spirituelle.
Hortus medicus : Jardin monastique réservé aux plantes médicinales.
Hortulus : Petit jardin monastique, popularisé par l’œuvre de Walafrid Strabo.
Hysope : Plante médicinale associée à la purification rituelle et cultivée dans les jardins monastiques.
I
Iconographie médiévale : Étude des représentations artistiques des jardins médiévaux.
Irrigation médiévale : Techniques d’arrosage utilisant canaux rudimentaires et rigoles.
Irrigation souterraine : Système d’arrosage basé sur des canalisations souterraines.
J
Jardin castral : Jardin aménagé dans un château médiéval, combinant potager, verger et espace de détente.
Jardin communautaire : Espace partagé utilisé pour compléter l’approvisionnement en nourriture.
Jardin d’agrément : Jardin conçu pour la contemplation et le loisir.
Jardin des simples : Jardin médicinal cultivé dans les monastères.
Jardin potager : Espace de culture destiné à la production de légumes et herbes aromatiques.
Jardin vivrier : Jardin destiné à la production alimentaire complémentaire.
Jardin maraîcher : Espace consacré à la culture intensive de légumes et d’herbes aromatiques.
L
Land art : Utilisation d’éléments naturels pour créer des œuvres intégrées aux jardins historiques.
Locus amoenus : Concept littéraire désignant un jardin idyllique propice à la contemplation.
M
Maraîchage médiéval : Culture de légumes et plantes alimentaires essentielle à l’alimentation médiévale.
Médecine monastique : Système de soins à base de plantes cultivées dans les jardins monastiques.
Monachisme : Mode de vie religieux incluant l’entretien des jardins comme acte de spiritualité.
Mulching : Technique de couverture du sol inspirée des pratiques agricoles médiévales.
Murets en pierre sèche : Structures sans mortier servant à délimiter les jardins.
O
Onguentarium : Partie du jardin monastique réservée aux plantes aromatiques et médicinales.
Orto : Terme médiéval italien désignant un jardin potager.
P
Palissade : Clôture en bois protégeant les jardins des intrusions.
Paradis terrestre : Jardin idéal dans la conception médiévale chrétienne.
Parterre : Zone cultivée dans un jardin, souvent délimitée par des bordures.
Plantes médicinales : Espèces végétales aux vertus curatives cultivées dans les jardins monastiques.
Q
Quadripartition : Organisation en quatre parties d’un jardin médiéval.
Quatre fleuves du paradis : Référence biblique souvent représentée dans les jardins médiévaux.
R
Roman de la Rose : Œuvre médiévale où le jardin est un espace allégorique.
S
Simples : Plantes médicinales utilisées en pharmacopée médiévale.
Symbolisme végétal : Attribution d’une signification religieuse aux plantes.
T
Tacuinum Sanitatis : Traité médiéval détaillant les vertus des plantes.
Treille : Structure permettant la croissance des plantes grimpantes.
V
Vergier (ou Verger) : Jardin fruitier médiéval, associé à la fertilité et la spiritualité.
Vitraux horticoles : Fenêtres ornées représentant des scènes de jardins.
Iconographie

Le Plan de Saint-Gall (vers 820-830)
Encre rouge sur parchemin, 112 × 77,5 cm, Bibliothèque de l'Abbaye de Saint-Gall, Codex Sangallensis 1092.
Le Plan de Saint-Gall est le plus ancien plan architectural monastique connu de l’époque médiévale. Réalisé au début du IXe siècle dans le contexte de la réforme carolingienne, il illustre l’idéal d’un monastère bénédictin parfaitement organisé, structuré autour des principes de la Regula Benedicti.
Description et signification
Un modèle idéal plutôt qu’un plan de construction réel : Bien que ce plan n’ait jamais été entièrement réalisé, il sert de référence pour comprendre l’organisation des monastères médiévaux.
Disposition rationnelle : Le plan présente les bâtiments monastiques autour de la basilique abbatiale, avec des espaces distincts dédiés à la prière, au travail et à l’hospitalité.
Éléments architecturaux et annotations
Église abbatiale (centre du plan)
Organisation basilicale avec nef, transept et chœur.
Cloître central servant de cœur spirituel du monastère.
Hortus, Herbularius et Viridarium (en bas à droite)
Hortus : Potager destiné à l’alimentation des moines.
Herbularius : Jardin médicinal pour la préparation des remèdes.
Viridarium : Verger symbolisant l’abondance et le Paradis terrestre.
Bâtiments de vie communautaire
Scriptorium et bibliothèque : Lieu de copie des manuscrits et transmission du savoir.
Réfectoire : Salle de repas des moines, attenante à la cuisine.
Hospice : Accueil des pèlerins et des voyageurs, en accord avec la règle de Saint Benoît.
Parties agricoles et artisanales (périphérie du plan)
Granges, moulins et étables illustrent l’autosuffisance économique du monastère.
Brasserie et boulangerie, attestant de l’importance de la production alimentaire.
Importance historique
Le Plan de Saint-Gall témoigne de la rigueur intellectuelle et architecturale des Carolingiens, intégrant des principes de rationalisation des espaces religieux et économiques. Il reste une source inestimable pour comprendre le mode de vie monastique médiéval.

Reconstitution du monastère de Saint-Gall selon le plan de 830
Dessin de Johann Rudolf Rahn, d'après Lasius, 1876.
Cette illustration propose une reconstruction tridimensionnelle du monastère de Saint-Gall tel qu’il aurait pu être construit d’après le célèbre plan du IXe siècle. L’artiste Johann Rudolf Rahn, en s’inspirant des recherches de Lasius, donne une vision concrète de l’architecture et de l’organisation spatiale du monastère idéal carolingien.
L’image met en évidence :
L’église abbatiale, monumentale et flanquée de deux tours, au centre de la vie monastique.
Le cloître, espace spirituel entouré des bâtiments essentiels à la vie des moines.
Les cellules monastiques, disposées en rangées ordonnées, illustrant la rigueur de la vie bénédictine.
Les jardins et cours intérieures, dédiés aux cultures médicinales et aux vergers.
Les infrastructures agricoles et artisanales, démontrant l’autosuffisance du monastère.
Ce dessin restitue l’ambition du plan de Saint-Gall, conçu comme un modèle architectural parfait pour la réforme monastique carolingienne.

Carte du premier âge ou situation du Paradis terrestre selon les divers auteurs
Gravure de François Desbrulins, XVIIe-XVIIIe siècle
Source : Bibliothèque nationale de France (Gallica)
Cette carte illustre les diverses hypothèses sur la localisation du Paradis terrestre, en se basant sur les descriptions bibliques du livre de la Genèse et les interprétations des savants de l’époque. L’un des éléments centraux de ces hypothèses repose sur les quatre fleuves mentionnés dans la Genèse (Gn 2:10-14), qui auraient pris leur source dans l'Éden.
Les quatre fleuves du Paradis
Dans la tradition biblique, un fleuve unique sort de l’Éden et se divise en quatre bras, qui irriguent la terre :
Pishon (Phison)
Souvent associé au Gange ou à un fleuve d’Arabie.
Il est censé traverser un pays riche en or et en pierres précieuses (Havilah).
Gihon (Geon)
Parfois identifié au Nil ou à un cours d’eau de l’Afrique orientale.
Il est censé couler autour du pays de Cusch (Coush), une région souvent associée à l’Éthiopie.
Tigre (Hiddekel)
Un fleuve bien connu, qui traverse l'Assyrie et passe par Ninive.
Il est encore visible aujourd’hui en Irak et Turquie.
Euphrate (Perath)
Le plus célèbre des quatre fleuves, qui traverse Babylone et alimente les terres de Mésopotamie.
Ces fleuves sont représentés sur la carte, en particulier dans la zone sud de la Mésopotamie, où plusieurs auteurs situaient le Paradis terrestre. La présence de ces cours d'eau a conduit certains théologiens et géographes à placer l’Éden à l’intersection du Tigre et de l’Euphrate, dans l’actuel Irak.
Annotations et symboles notables
Eden (zone jaune au nord)
Localisation supposée du Jardin d’Éden, près de l'Arménie et des sources du Tigre et de l’Euphrate.
Théorie fondée sur l’idée que les fleuves prennent naissance à cet endroit.
Paradis terrestre (cercle jaune et rouge au sud)
Situé près du golfe Persique, où les quatre fleuves se rejoindraient avant de se séparer.
Hypothèse soutenue par certains érudits qui considéraient Babylone comme proche du site originel.
Les mers et repères géographiques
Mer Caspienne, Mer Noire, Mer Méditerranée et Golfe Persique : points de repère importants pour situer l’Éden dans le contexte du monde connu à l’époque.
Signification et héritage
Cette carte reflète la fascination des érudits de l’époque pour la géographie sacrée, tentant de localiser physiquement des lieux décrits dans la Bible. La présence des quatre fleuves souligne leur importance symbolique et théologique, représentant l’abondance, la fertilité et la connexion entre le divin et le monde terrestre.

Le Paradis terrestre
Les Très Riches Heures du duc de Berry, musée Condé, Ms.65, folio 25.
Cette enluminure, extraite du célèbre manuscrit Les Très Riches Heures du duc de Berry (XVe siècle), représente le Jardin d’Éden, un espace sacré de perfection divine selon la tradition chrétienne. Peinte avec une finesse remarquable par les frères de Limbourg, elle illustre plusieurs moments clés du récit biblique de la Genèse.
Description et analyse de la scène
L’image est structurée en un espace circulaire clos, entouré d’eau et de montagnes, une forme évoquant la conception médiévale du hortus conclusus (jardin clos), symbole de pureté et de perfection.
Le centre du jardin : un édifice gothique
Représente l’Arbre de Vie ou une structure céleste évoquant la Jérusalem céleste.
Ses hautes flèches et son architecture raffinée renforcent son caractère divin et parfait.
Les scènes bibliques représentées :
À gauche : La Tentation → Ève cueille le fruit défendu du serpent enroulé autour de l’arbre, tandis qu’Adam, déjà marqué par la faute, se couvre le visage.
Au centre : La Création d’Ève et son union avec Adam → Dieu, vêtu d’un manteau bleu, unit les mains des premiers humains dans une scène nuptiale.
À droite : L’expulsion du Paradis → Un ange à l’épée flamboyante chasse Adam et Ève, désormais honteux et vêtus de feuilles de figuier, vers le monde terrestre.
Éléments symboliques et annotations
L’Arbre du Bien et du Mal (gauche)
Enroulé par le serpent, il représente la tentation et la chute de l’humanité.
L’architecture gothique centrale
Inspirée des cathédrales médiévales, elle évoque le divin et le Paradis céleste.
L’ange à l’épée rouge (droite)
Il symbolise la justice divine, condamnant Adam et Ève à l’exil.
Les eaux entourant le jardin
Elles évoquent l’isolement sacré du Paradis, un lieu inaccessible aux mortels.
Signification et héritage
Cette enluminure illustre la vision médiévale du Paradis terrestre, à la fois jardin d’abondance et espace sacré. Son iconographie raffinée reflète l’influence de la théologie chrétienne et des conventions artistiques gothiques du XVe siècle.

Les enluminures du Tacuinum Sanitatis (XIVe siècle) – Bibliothèque nationale de France, ms. Latin 9333
Cette enluminure issue du célèbre Tacuinum Sanitatis illustre une scène de cueillette et d’ornementation florale dans un jardin médiéval. Elle met en lumière la double fonction de ces espaces clos : lieux de plaisir et de contemplation, mais aussi de culture savante et médicinale.
Le jardin médiéval : un espace structuré et symbolique
L’organisation rigoureuse des jardins
Les jardins médiévaux, qu’ils soient monastiques, princiers ou médicinaux, étaient conçus en fonction de la symbolique chrétienne et d’une connaissance précise des propriétés des plantes.
Cette enluminure montre une clôture végétale dense, rappelant le concept du hortus conclusus, un jardin clos évoquant à la fois la Vierge Marie et le paradis perdu.
Un jardin d’agrément et de bien-être
La scène dépeint une société raffinée, où hommes et femmes se couronnent de fleurs, illustrant le rôle du jardin comme espace de sociabilité et de détente.
Ces fleurs, probablement des roses et des œillets, étaient cultivées à la fois pour leur parfum, leur valeur symbolique et leurs vertus médicinales.
Les jardins comme espaces médicinaux et alimentaires
Dans le contexte du Tacuinum Sanitatis, chaque plante est associée à un usage thérapeutique.
Les jardins médiévaux comprenaient souvent des herbes médicinales comme la sauge, le romarin et la lavande, utilisées dans les traitements médicaux médiévaux.
Conclusion – Un microcosme du savoir médiéval
Cette enluminure du Tacuinum Sanitatis met en valeur l’importance des jardins médiévaux en tant que lieux de culture (botanique et sociale), de médecine et de spiritualité. Ils sont le reflet d’un savoir savant hérité des monastères, où chaque plante, chaque geste et chaque couleur avait une signification précise.

Le Jardin des Délices (vers 1490-1510) – Jérôme Bosch
Huile sur panneau de bois, 220 × 389 cm, Musée du Prado, Madrid.
Ce triptyque fascinant de Jérôme Bosch est une œuvre emblématique de l’art du XVe siècle, combinant symbolisme religieux, fantastique et satire morale. Il se compose de trois panneaux :
Panneau gauche – Le Paradis
Représente la Genèse avec Dieu présentant Ève à Adam dans un paysage luxuriant et foisonnant d’animaux exotiques et de plantes étranges.
Symbolisme biblique du Jardin d’Éden, dominé par des structures organiques et des créatures hybrides.
Panneau central – Le Jardin des Délices
Une scène idyllique et mouvementée montrant des humains nus livrés à des plaisirs sensuels, entourés de fruits géants et de structures fantastiques.
Réflexion sur la tentation, la luxure et la vanité humaine dans un univers où les lois naturelles semblent suspendues.
Panneau droit – L’Enfer
Représentation cauchemardesque d’un enfer peuplé de créatures démoniaques et de supplices étranges.
Allusion aux péchés terrestres punis par des tortures absurdes et surréalistes.

Le Jardin de Paradis (Paradiesgärtlein) – Maître du Haut-Rhin, vers 1410
Tempera sur bois, 26 × 33 cm, Städelsches Kunstinstitut, Francfort-sur-le-Main.
Cette peinture gothique tardive illustre un hortus conclusus (jardin clos), symbole marial typique de l’iconographie médiévale. Ce type de représentation met en scène la Vierge Marie dans un jardin idéalisé, reflet du Paradis terrestre, où la nature est en harmonie avec la spiritualité.
Description et interprétation
Vierge Marie (centre) : Assise sous un arbre, elle est couronnée et vêtue de bleu et de rouge, couleurs traditionnelles mariales. Elle lit un livre, symbole de sagesse et de méditation.
L’ange et le chevalier (droite) : Représentent la dualité entre le monde céleste et terrestre. Le chevalier, en position humble, semble chercher la faveur divine.
Femme en blanc et bleu (gauche, près du bassin) : Elle puise de l’eau, symbole de pureté et de vie spirituelle.
Femme cueillant un fruit (gauche, près de l’arbre) : Évoque Ève dans le Jardin d’Éden, mais ici sous une vision positive liée à l’abondance paradisiaque.
Éléments symboliques
Jardin clos : Muraille blanche évoquant la virginité et la protection divine.
Fleurs et plantes : Lilas, iris, et roses symbolisent la pureté, la passion divine et la Vierge Marie.
Table avec fruits et boisson : Allusion à l’Eucharistie et à la nourriture spirituelle.
Oiseaux et petits animaux : Éléments de la nature idéalisée, évoquant la paix et l’harmonie divine.

La Dame à la Licorne – Un Jardin Médiéval Allégorique
Tapisserie flamande, fin du XVe siècle – Musée de Cluny, Paris
La célèbre série de tapisseries La Dame à la Licorne est une représentation emblématique de l’univers médiéval, où le jardin clos (hortus conclusus) devient un espace de symbolisme et de raffinement. Commandées par une famille noble, ces tapisseries illustrent la thématique des cinq sens et une sixième tapisserie au message plus mystérieux, le tout dans un cadre luxuriant inspiré des jardins médiévaux.
Un jardin médiéval symbolique et esthétique
L’arrière-plan végétal : un paradis floral
La tapisserie est saturée de motifs floraux et d’arbres fruitiers, illustrant un jardin d’agrément médiéval.
Des orangers, des chênes et des grenadiers symbolisent l’amour, la sagesse et la fécondité.
Les petites fleurs bleues et rouges rappellent les prairies fleuries cultivées dans les jardins aristocratiques.
Le hortus conclusus : un jardin clos
L’espace ovale sur lequel se tient la dame est délimité comme un jardin isolé du monde extérieur, évoquant les jardins privés des châteaux.
Ce jardin symbolise à la fois la pureté et l’introspection, un lieu de méditation et d’apprentissage des vertus courtoises.
Les tapisseries et leurs liens avec les jardins médiévaux
Les cinq sens et leur cadre naturel
Le toucher : La dame caresse la corne de la licorne, soulignant la sensorialité du monde végétal et animal.
Le goût : Elle prend une friandise d’un coffret, entourée de fruits exotiques comme des agrumes, caractéristiques des jardins de plaisance aristocratiques.
L’odorat : Elle tient une fleur, tandis qu’un singe s’enivre du parfum d’une rose, rappelant l’usage des jardins pour la culture de plantes odorantes et médicinales.
L’ouïe et la vue sont aussi illustrées dans d’autres tapisseries avec des instruments et des miroirs, reliant la nature aux plaisirs intellectuels.
Les animaux dans le jardin médiéval
La licorne et le lion sont des figures héraldiques, mais aussi des symboles liés aux vertus et à l’amour courtois.
Les oiseaux et les petits mammifères (lapins, singes) témoignent du caractère vivant et enchanteur du jardin, comme c’était le cas dans les enclos nobles.
Un jardin médiéval comme espace idéalisé
Ces tapisseries reflètent la vision aristocratique du jardin au Moyen Âge :
Un lieu de plaisir, de contemplation et de raffinement.
Un espace clos, entre nature domestiquée et paradis spirituel.
Une métaphore de la courtoisie et de l’amour, dans la lignée des jardins décrits dans le Roman de la Rose.

Miniature introductive du Roman de la Rose, folio 1
Manuscrit enluminé, Bodleian Library, Ms. Douce 195
Cette enluminure ouvre le célèbre Roman de la Rose, un poème allégorique du XIIIe siècle écrit par Guillaume de Lorris et complété par Jean de Meun. Ce texte médiéval, à la fois récit d’amour courtois et traité philosophique, illustre la quête de l’amant pour la Rose, symbole de l’amour idéal.
Description de la miniature
L’image est divisée en deux scènes principales, encadrées par une architecture gothique raffinée, séparées par une colonne centrale :
À gauche : L’écrivain au travail
Un scribe en robe bleue et rouge, sans doute une représentation de l’auteur ou du narrateur, est assis à son pupitre, absorbé dans l’écriture.
Deux personnages apparaissent à une fenêtre en arrière-plan, témoignant peut-être de la réception du texte.
L’espace est intime et studieux, renforçant l’idée d’un texte conçu dans la tradition intellectuelle médiévale.
À droite : Le rêveur dans son lit
Un jeune homme allongé sur un lit vert, vêtu d’une tunique rouge, symbolise le narrateur du poème, qui va entrer dans un songe initiatique.
Son chien blanc, allongé à ses pieds, est un symbole de loyauté et de quiétude.
Cette scène marque le début du voyage onirique dans le jardin allégorique où se déroule l’action du Roman de la Rose.
Ornementation et éléments symbolique
Bordure florale enluminée
Composée de feuillages délicats, de fleurs (roses, campanules) et de fruits (grenade, fraises), évoquant le thème de la nature et de l’amour courtois.
Figures marginales
Dans la marge de droite, un petit personnage semble grimper aux tiges florales, soulignant la dimension allégorique du texte et son rapport avec la nature.
Texte en lettres gothiques ornées
Utilisation d’enluminures dorées et de lettrines colorées pour démarquer le début du récit.
Interprétation et contexte
Le Roman de la Rose est un chef-d’œuvre de la littérature médiévale qui mêle allégorie, amour courtois et réflexion philosophique. Cette première page enlumine brillamment son atmosphère introspective et onirique, plongeant le lecteur dans une aventure intellectuelle et sentimentale.

Miniature du Livre des simples médecines (XVe siècle)
Source : Bibliothèque nationale de France, ms. Français 12322.
Cette enluminure illustre l’importance des jardins médicinaux monastiques, appelés herbularius, où les plantes étaient cultivées pour leurs vertus thérapeutiques. Le manuscrit, attribué à l’École de médecine de Montpellier, témoigne du savoir botanique du Moyen Âge et de la transmission des connaissances médicales par les moines et les savants.
Les jardins médicinaux : un centre de soins et de savoir
L’herbularius : un jardin structuré et utilitaire
Situé à proximité des monastères, l’herbularius était divisé en parcelles dédiées aux plantes médicinales, classées selon leurs usages thérapeutiques.
Ce type de jardin s’inspire des jardins antiques, notamment des connaissances héritées de Dioscoride et de Galien.
Les plantes médicinales et leurs propriétés
À gauche, on reconnaît la guimauve (Althaea officinalis), utilisée pour ses propriétés émollientes et expectorantes dans le traitement des inflammations et des affections respiratoires.
La morelle noire (Solanum nigrum), située à côté, était connue pour ses effets sédatifs et analgésiques, mais aussi pour sa toxicité lorsqu’elle est mal dosée.
À droite, le carex (Carex sp.) et la scolopendre (Asplenium scolopendrium), des plantes souvent utilisées dans la médecine monastique, notamment pour leurs bienfaits sur les affections urinaires et respiratoires.
Un savoir conservé dans les manuscrits médicaux
Ce manuscrit appartient à la tradition des "livres des simples", des ouvrages recensant les plantes et leurs applications en pharmacopée médiévale.
La transmission de ces savoirs médicinaux était essentielle pour soigner les maladies en l’absence de médecine moderne, reposant principalement sur les remèdes naturels et les pratiques monastiques.
Conclusion – Un jardin au cœur du soin et du savoir
Cette miniature du Livre des simples médecines illustre l’importance des jardins médicinaux médiévaux, où la nature était un remède, et le jardin, un espace de connaissance et de transmission. Grâce à ces pratiques, une partie du savoir botanique antique a pu être préservée et enrichie au fil des siècles.

Enluminure du XVe siècle
Source : Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5067.
Cette enluminure illustre un jardin potager médiéval, conçu selon une organisation rigoureuse et fonctionnelle. Il met en scène des jardiniers au travail, pratiquant la culture et l’entretien des parcelles, sous l’œil attentif d’un noble ou d’un maître d’ouvrage.
Le jardin potager médiéval : un espace structuré et essentiel
Un espace quadrillé et fonctionnel
Le potager est organisé en parcelles rectangulaires, séparées par des allées de circulation.
Ce type de disposition facilite l’irrigation, l’entretien des cultures, et permet d’optimiser la production des légumes et des plantes aromatiques.
Les techniques agricoles médiévales
Les jardiniers utilisent des outils simples, comme la bêche et le couteau, pour sarcler et entretenir les cultures.
On distingue différents gestes agricoles : arrosage, taille, désherbage et entretien des jeunes pousses.
Ces techniques sont héritées des savoirs antiques et monastiques, diffusés à travers des traités comme le Rustican de Pierre de Crescens (XIIIe siècle), qui influença les pratiques agricoles médiévales.
Un jardin rattaché à un domaine seigneurial
L’enluminure montre un jardin intégré à un ensemble castral, protégé par des murs et jouxtant une demeure seigneuriale.
Ces jardins, souvent situés près des châteaux ou monastères, assuraient une autonomie alimentaire pour les résidents.
Les cultures et usages du potager médiéval
Une diversité de légumes et d’herbes
Parmi les cultures les plus courantes dans les jardins médiévaux, on trouvait :
Les plantes aromatiques : thym, sauge, persil, coriandre.
Les légumes racines : carottes, navets, betteraves.
Les légumes-feuilles : chou, laitue, bette.
Les fleurs comestibles et médicinales : bourrache, souci, rose.
Un jardin à vocation utilitaire
Le potager ne servait pas uniquement à l’alimentation mais aussi à la médecine et à la cuisine.
De nombreuses herbes cultivées avaient des vertus thérapeutiques et entraient dans la préparation des remèdes monastiques.
Les légumes produits assuraient une diète équilibrée, particulièrement dans les communautés religieuses et nobles, où les restrictions alimentaires imposaient une forte consommation de légumes.
Conclusion – Le jardin potager, un pilier de l’autosuffisance médiévale
Loin d’être un simple espace de culture, le potager médiéval était un élément vital des seigneuries et monastères, assurant une production nourricière diversifiée et essentielle à la vie quotidienne. Cette enluminure offre une vision précieuse des pratiques agricoles médiévales, alliant organisation, savoir-faire et respect des saisons.

Miniature des Très Riches Heures du Duc de Berry (XVe siècle)
Source : Musée Condé, Chantilly
Cette suite de miniatures représente le cycle des saisons à travers les travaux des champs et des jardins médiévaux. Chaque scène illustre les interactions entre l’homme et la nature, mettant en valeur la diversité des jardins médiévaux, depuis les potagers jusqu’aux jardins d’agrément.
Les jardins médiévaux à travers les saisons
Le printemps : la fertilité et le renouveau
Les mois de mars et avril mettent en avant des scènes de labours, semis et jardinage, reflétant l’importance des potagers et jardins nourriciers.
Le mois de mai est associé aux jardins d’agrément, où l’aristocratie se promène au milieu de vergers en fleurs.
L’été : la récolte et l’entretien des jardins
Les mois de juin et juillet montrent les travaux agricoles intensifs : fauchage des blés, récolte des légumes et entretien des parterres.
Les jardins monastiques et seigneuriaux restent des espaces de repos et de contemplation, notamment à l’ombre des tonnelles.
L’automne : le temps des moissons et des vendanges
Septembre illustre les vendanges, un moment clé dans les cultures monastiques et seigneuriales.
Octobre et novembre montrent l’entretien des vergers, le ramassage des fruits et la préparation des jardins pour l’hiver.
L’hiver : un temps de repos et de préparation
Les scènes hivernales mettent en évidence la protection des cultures, le stockage des récoltes et la préparation des sols pour la saison suivante.
Même en hiver, les jardins des monastères restaient actifs pour la culture des plantes médicinales sous abri.
Les différents types de jardins représentés
Les jardins seigneuriaux et princiers
Présents dans les scènes de mai et juin, ces jardins étaient des espaces de détente et de prestige.
Ils étaient souvent composés de vergers, fontaines et allées ornées, avec une forte symbolique de paradis terrestre.
Les jardins potagers et vergers nourriciers
Les scènes de mars à octobre illustrent les jardins utilitaires, où légumes et fruits étaient cultivés pour la consommation des seigneurs et des paysans.
On y voit des cultures de légumes à racines, céréales, vignes et arbres fruitiers.
Les jardins monastiques et médicinaux
Bien que moins visibles dans cette série, les monastères possédaient des jardins clos dédiés à la culture des simples (plantes médicinales).
Ces jardins, inspirés des herbularius antiques, servaient aux soins des malades et à la préparation des remèdes.
Conclusion – L’organisation des jardins au cœur du monde médiéval
Les Très Riches Heures du Duc de Berry offrent un aperçu fascinant de la diversité et de l’organisation des jardins médiévaux, en lien avec les cycles agricoles et sociaux. De l’utilitaire au décoratif, du potager au jardin princier, ces espaces structuraient la vie des hommes et témoignent d’un savoir-faire ancestral.

Jardin d’amour à la cour de Philippe le Bon
Anonyme, XVe siècle – Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
Ce tableau illustre un jardin d’amour courtois, un espace à la fois réel et allégorique, emblématique de l’aristocratie bourguignonne sous le règne de Philippe le Bon (1396-1467). Le jardin clos, un élément fondamental des jardins médiévaux, est ici un décor de sociabilité raffinée où se mêlent amour courtois, divertissements et nature domestiquée.
Un jardin médiéval comme espace de sociabilité
Un jardin clos et structuré
Entouré de palissades et d’une bâtisse aux allures de locus amoenus (lieu idyllique), ce jardin incarne la notion de refuge et de protection, caractéristique des jardins aristocratiques du Moyen Âge.
La nature y est maîtrisée : on aperçoit des arbres taillés et une prairie verdoyante qui contrastent avec le paysage plus sauvage de l’arrière-plan.
Une scène d’amour courtois
Les nobles, vêtus de blanc – couleur de la pureté et de la distinction –, déambulent et conversent selon les codes de la courtoisie médiévale.
Le raffinement de la cour bourguignonne se traduit par la musique, les échanges galants et le luxe des vêtements.
Les activités du jardin
Jeux de cour et festins : une table dressée témoigne de l’art de vivre aristocratique.
Musique et danse : des musiciens accompagnent les conversations et renforcent le caractère harmonieux de la scène.
Symboles de l’amour et de la chasse : le faucon, le lévrier et les tournois à l’arrière-plan rappellent le parallèle médiéval entre la chasse et la conquête amoureuse.
Un jardin symbolique et fonctionnel
Le jardin médiéval et son organisation
Inspiré des hortus conclusus, ce jardin est un espace à la fois esthétique et fonctionnel, intégrant des éléments d’agrément et de représentation sociale.
Il rappelle les jardins d’amour chantés dans la littérature courtoise et représentés dans les manuscrits enluminés.
L’amour et la nature maîtrisée
Ce jardin est un écho aux descriptions des jardins du Roman de la Rose, où la nature devient le cadre de l’apprentissage amoureux.
La présence d’arbres fruitiers et de végétation bien ordonnée traduit la conception médiévale du jardin comme un espace harmonieux, entre paradis terrestre et construction humaine.
Un jardin en opposition au monde extérieur
À l’arrière-plan, des combats et des tournois montrent un contraste entre l’univers policé du jardin et la rudesse du monde extérieur, renforçant l’idée du jardin comme lieu de paix et de raffinement.
Conclusion
Ce tableau est une représentation parfaite du jardin aristocratique médiéval, où l’amour courtois, la nature et les codes de la noblesse s’entrelacent. Il illustre les thématiques des jardins médiévaux abordées dans les documents transmis, en mettant en lumière le jardin clos comme espace d’échange social, de plaisir et de représentation du pouvoir.

Arrachage d'une mandragore – Une plante mystérieuse des jardins médiévaux
Manuscrit Tacuinum Sanitatis, Bibliothèque nationale de Vienne, vers 1390
Cette enluminure illustre l’arrachage d’une mandragore, une plante aux puissantes propriétés médicinales et magiques, souvent cultivée dans les jardins médiévaux à usage thérapeutique. Issue du Tacuinum Sanitatis, un traité médical médiéval d’origine arabe, cette image témoigne du savoir botanique médiéval et de la transmission des connaissances sur les plantes.
Une plante entre médecine et superstition
La mandragore et ses vertus
Connue pour ses racines anthropomorphes, elle était utilisée pour ses effets anesthésiants et sédatifs, notamment en chirurgie.
Selon les herboristes médiévaux, elle pouvait aussi soigner l’insomnie, les troubles nerveux et la mélancolie.
Un arrachage rituel et prudent
La légende voulait que la mandragore pousse sous les gibets et émette un cri mortel lorsqu’elle était déracinée.
Pour éviter ce danger, il était conseillé d’utiliser un chien attaché à la racine, qui tirait la plante tandis que l’homme se bouchait les oreilles.
Cette croyance, bien que superstitieuse, montre comment le savoir médical médiéval cohabitait avec des pratiques rituelles.
Un élément essentiel des jardins médiévaux
La mandragore faisait partie des plantes cultivées dans les jardins monastiques et princiers, où elle était protégée pour son usage médicinal.
Elle était souvent plantée dans le herbularius, un espace réservé aux plantes médicinales dans les jardins monastiques et hospitaliers.
Conclusion – La mandragore, un héritage des jardins médiévaux
Cette enluminure du Tacuinum Sanitatis témoigne de l’intérêt des médecins et botanistes médiévaux pour les plantes médicinales et de leur intégration dans les jardins clos des monastères et des cours princières. Elle illustre également la persistance des croyances magiques associées aux plantes, qui ont perduré jusqu’à la Renaissance.

Hysope officinale (Hyssopus officinalis L.) – Une plante médicinale des jardins médiévaux
Illustration botanique, Famille des Lamiacées
L’hysope (Hyssopus officinalis), plante vivace de la famille des Lamiacées, était une composante essentielle des jardins médiévaux, notamment dans les jardins monastiques et médicinaux. Elle était cultivée pour ses propriétés médicinales, culinaires et symboliques.
L’hysope dans les jardins médiévaux
Un élément du hortus medicus
L’hysope était couramment plantée dans le herbularius, la section des jardins monastiques dédiée aux plantes médicinales.
Son arôme puissant en faisait une plante prisée pour la purification de l’air et l’usage thérapeutique.
Propriétés médicinales et usages médiévaux
Utilisée pour traiter les affections respiratoires, elle était réputée pour ses vertus expectorantes et antiseptiques.
Les moines la cultivaient pour préparer des infusions contre la toux et les fièvres.
Elle entrait dans la composition de baumes et d’onguents, destinés à soigner plaies et infections.
Un condiment apprécié
Ses feuilles aromatiques étaient employées en cuisine médiévale pour assaisonner les viandes et les potages.
On en extrayait aussi une liqueur, ancêtre de certaines préparations monastiques comme la Chartreuse.
Conclusion – L’hysope, un indispensable des jardins médiévaux
Cette illustration botanique témoigne de l’importance de l’hysope dans les jardins médicinaux, monastiques et culinaires du Moyen Âge. À la fois plante médicinale et condimentaire, elle illustre parfaitement le savoir botanique médiéval, où chaque espèce avait une fonction précise pour le bien-être et la spiritualité.

La Récolte de l’Hysope – Une Plante Clé des Jardins Médiévaux
Codex Vindobonensis, series nova 2644 – Tacuinum Sanitatis, folio 33r (1370-1400)
Cette enluminure extraite du Tacuinum Sanitatis, un traité médical d’origine arabe diffusé en Europe au Moyen Âge, représente la récolte de l’hysope, une plante médicinale essentielle dans les jardins médiévaux monastiques et aristocratiques.
L’hysope dans les jardins médiévaux
Une plante médicinale majeure
Cultivée dans le herbularius, l’espace dédié aux plantes médicinales dans les jardins monastiques, l’hysope (Hyssopus officinalis) était utilisée en médecine pour ses propriétés antiseptiques, expectorantes et digestives.
Elle était un ingrédient essentiel des infusions et décoctions médicinales destinées à traiter les infections respiratoires, les troubles digestifs et les plaies.
Une plante liée à la purification et au sacré
Son nom est mentionné dans la Bible comme une plante de purification rituelle, ce qui explique son importance dans les jardins des monastères.
Elle servait également à assainir l’air des infirmeries médiévales.
Analyse de la scène
Un jardin structuré et organisé
L’image montre un alignement ordonné d’hysope, typique des jardins médiévaux, où les plantes étaient cultivées en rangs bien entretenus.
À l’arrière-plan, un grand arbre renforce la profondeur et évoque la diversité des plantes médicinales.
Le rôle des femmes dans les jardins médiévaux
La scène illustre deux femmes récoltant soigneusement les branches d’hysope, soulignant le rôle des guérisseuses et des soignantes dans la préparation des remèdes à base de plantes.
L’une coupe les tiges avec un couteau, tandis que l’autre semble humer les feuilles, évoquant l’importance des propriétés aromatiques et médicinales de la plante.
L’hysope, un élément central du jardin médiéval
Utilisation dans la cuisine et la médecine
En plus de ses vertus thérapeutiques, l’hysope était utilisée comme condiment dans les plats médiévaux.
Elle aromatisait les viandes, les soupes et les vins médicinaux.
Présence dans les jardins aristocratiques et monastiques
L’hysope était souvent cultivée dans les jardins clos, symbole de protection et de maîtrise de la nature.
Elle faisait partie des plantes incontournables des jardins princiers et des cloîtres, servant à la fois de remède, de plante aromatique et de barrière naturelle contre les maladies.
Conclusion – Un savoir botanique médiéval transmis à travers les siècles
Cette enluminure témoigne du rôle fondamental des jardins médiévaux dans la conservation et la transmission du savoir médical et botanique. Elle met en lumière l’usage quotidien des plantes médicinales comme l’hysope, à la croisée entre science, spiritualité et pratiques agricoles.

La Vision de Sainte Hildegarde – Un Jardin Cosmique et Spirituel
Hildegarde de Bingen, Scivias, Codex illuminatus, vers 1180
Cette enluminure provient du Scivias, une œuvre visionnaire de Sainte Hildegarde de Bingen (1098-1179), abbesse, théologienne et naturaliste médiévale. Elle illustre une vision cosmique de la création, où le lien entre spiritualité, nature et cosmos est omniprésent.
Une vision médiévale du jardin divin
L’univers comme un jardin spirituel
L’image représente un univers ordonné, où la nature et les éléments cosmiques sont intrinsèquement liés.
Au centre, un arbre symbolique sépare deux mondes : le divin et le terrestre, rappelant le concept du jardin clos médiéval (hortus conclusus), un espace protégé et structuré.
Les sphères célestes et terrestres
L’orbe solaire en haut symbolise Dieu et la lumière divine, irriguant toute la création.
Le jardin terrestre en bas à droite illustre le paradis perdu et l’homme déchu, un motif récurrent dans les jardins monastiques, où la nature est perçue comme un lieu de salut et de méditation.
Les éléments de la nature dans la spiritualité médiévale
Un jardin de savoir et de médecine
Sainte Hildegarde, première naturaliste médiévale, concevait le jardin comme un réceptacle du savoir et des bienfaits médicinaux.
Ses écrits sur la botanique et la médecine monastique influencèrent l’organisation des jardins de simples, espaces dédiés aux plantes médicinales dans les abbayes.
Les astres et la fertilité du monde
Les étoiles, fleurs célestes, se reflètent dans les plantes du jardin, témoignant de la conception médiévale de l’harmonie entre macrocosme (ciel) et microcosme (terre).
L’homme âgé à droite représente la déchéance physique et spirituelle, rappelant que l’homme, privé de l’harmonie paradisiaque, doit retrouver son équilibre par la nature et la foi.
Un modèle pour les jardins médiévaux
Le jardin monastique inspiré du divin
L’image illustre comment les monastères médiévaux organisaient leurs jardins selon une vision spirituelle et cosmique.
Ces jardins servaient à la fois de lieux de contemplation et de guérison, inspirés par les principes d’Hildegarde, qui voyait dans chaque plante une signature divine.
Un savoir transmis dans les monastères
Les abbayes suivaient ses principes en intégrant des jardins de simples (plantes médicinales), des vergers et des potagers dans leurs enclos clos.
La structure géométrique et symbolique de ces jardins reflétait la croyance en un ordre divin où l’homme pouvait se régénérer.
Conclusion – La nature comme révélation divine
Cette vision d’Hildegarde illustre la pensée médiévale selon laquelle le jardin n’est pas qu’un lieu terrestre, mais une métaphore du cosmos et du salut. Son influence sur les jardins monastiques et les pratiques médicinales perdure encore aujourd’hui, où son approche de la nature alliant spiritualité et science inspire toujours.

Récolte du safran – Une précieuse épice des jardins médiévaux
IBN BUTLÂN, Tacuinum Sanitatis, BNF, Ms. Latin 9333, folio 37v
Cette enluminure tirée du Tacuinum Sanitatis, un traité médical médiéval d’origine arabe, illustre la récolte du safran (Crocus sativus), une plante précieuse cultivée dans les jardins médiévaux, à la fois pour ses propriétés médicinales, culinaires et teinturières.
Le safran dans les jardins médiévaux
Un trésor cultivé dans les hortus conclusus
Le safran était une plante précieuse des jardins monastiques et princiers, souvent planté dans des parcelles dédiées aux plantes médicinales et aromatiques.
Sa culture nécessitait des sols bien drainés et un climat tempéré, ce qui explique sa rareté et sa grande valeur.
Vertus médicinales et usages thérapeutiques
Réputé pour ses propriétés digestives, sédatives et anti-inflammatoires, il était utilisé en infusion et en onguents pour traiter douleurs et insomnies.
Selon les connaissances transmises par Hildegarde de Bingen et d’autres médecins médiévaux, le safran était aussi considéré comme un tonique du cœur et un remède contre la mélancolie.
Une épice précieuse en cuisine
Le safran parfumait les plats médiévaux, notamment les bouillons, sauces et confiseries.
Sa rareté en faisait une épice de luxe, utilisée dans les banquets aristocratiques.
Utilisation dans la teinture
Ses stigmates rouges produisaient un colorant jaune d’or, employé dans les enluminures, textiles et teintures de la noblesse.
Conclusion – Un or rouge des jardins médiévaux
Cette enluminure illustre l’importance du safran dans la pharmacopée et l’économie médiévale, où les jardins étaient des centres de savoir, de soin et de spiritualité. Cultivé avec soin, il incarnait à la fois le luxe, la médecine et l’art, montrant comment la nature et la science se rejoignaient dans les jardins clos du Moyen Âge.

Gravure des jardins de Blois sous Louis XII (début XVIe siècle)
Source : Bibliothèque nationale de France, Département des estampes.
Une transition entre Moyen Âge et Renaissance
Cette gravure des jardins du château de Blois, réalisée sous le règne de Louis XII (1498-1515), illustre la mutation des jardins médiévaux vers les jardins de la Renaissance. Elle témoigne de la transition entre l’organisation médiévale, cloisonnée et fonctionnelle, et une nouvelle approche plus géométrique et esthétique.
Analyse et annotations du plan
Le château et ses espaces fortifiés
Le château, en rouge, conserve encore ses structures médiévales défensives avec ses remparts et ses tours.
La cour intérieure est un espace clos, caractéristique des châteaux du Moyen Âge.
Les jardins en mutation
À gauche du plan, un verger enclos rappelle les hortus conclusus médiévaux, où arbres fruitiers et cultures nourricières étaient protégés.
Au centre, on observe l’apparition d’un jardin de parterre organisé en carrés, annonçant l’influence italienne sur le jardin français de la Renaissance.
Les allées arborées et les bosquets montrent une volonté de domestiquer la nature et d’embellir le paysage, en opposition avec les jardins purement utilitaires du Moyen Âge.
Un jardin de prestige et de plaisir
Contrairement aux jardins médiévaux strictement fonctionnels (nourriture, plantes médicinales), les jardins de Blois commencent à intégrer des espaces de promenade et de contemplation.
L’influence de la symétrie et de la perspective, empruntée aux modèles italiens, se distingue dans l’agencement des allées et des espaces végétaux.
L’impact sur les jardins post-médiévaux
L’influence italienne et la Renaissance française
L’organisation en parterres géométriques et la présence de bassins et d’allées annoncent l’évolution vers les jardins à la française, tels que ceux d’André Le Nôtre au XVIIe siècle.
Un modèle pour les futurs jardins royaux
Ce type d’organisation sera perfectionné sous François Ier et Henri IV, influençant notamment les jardins de Fontainebleau et de Chenonceau.
La séparation entre espaces utilitaires (vergers, potagers) et espaces ornementaux devient plus marquée, ouvrant la voie aux grands jardins de plaisance.
Une esthétique qui perdure
L’idée d’un jardin structuré en terrasses et en perspectives, né à Blois sous Louis XII, devient un modèle dans toute l’Europe.
Les châteaux de la Loire en conserveront l’héritage, tout en y intégrant des éléments d’inspiration italienne et plus tard classique.
Conclusion – Le jardin de Blois, un tournant dans l’histoire des jardins
Entre Moyen Âge et Renaissance, le jardin de Blois incarne une transformation majeure : il n’est plus seulement un espace de culture et de survie, mais devient un élément de prestige et de mise en scène du pouvoir royal.

Les plans du Potager du Roi à Versailles (XVIIe siècle)
Source : École nationale supérieure de paysage, Versailles.
Un héritage des jardins médiévaux et monastiques
Le Potager du Roi, conçu par Jean-Baptiste de La Quintinie à partir de 1678 à la demande de Louis XIV, s’inscrit dans une tradition horticole héritée des jardins médiévaux et monastiques. Sa structure rigoureuse en carrés horticoles, ses allées ordonnées et l’intégration d’une gestion savante des cultures rappellent les principes de l’hortus conclusus médiéval.
Un modèle d’influence internationale
Ce potager servira de modèle pour les jardins de production en France et en Europe, poursuivant ainsi l’héritage des jardins médiévaux dans une approche plus rationnelle et systématisée.
Il inspire encore aujourd’hui les pratiques en permaculture et agriculture raisonnée, mettant en avant les principes d’association des cultures et de gestion des ressources hérités du Moyen Âge.
Conclusion – Un lien direct entre les jardins médiévaux et la modernité
Le Potager du Roi, bien qu’ancré dans l’esthétique et la rigueur de l’époque classique, reste un témoignage direct des savoirs et de l’organisation des jardins médiévaux.
Il illustre la continuité entre les pratiques monastiques du Moyen Âge et l’essor des jardins scientifiques sous Louis XIV, préfigurant les futurs jardins botaniques et agricoles de l’époque moderne.